|
|
|
|
|
|
|
|
| Droit de la famille | Droit des femmes | Droit des LGBT | Droit du travail | Pionnières | Travail et droit des enfants | Justice des mineurs |
Moyen-Âge
- du Ve au IXe siècle : le droit du mariage est tributaire des lois des différents peuples, des différentes villes gallo-romaines, de convictions civiles et religieuses. Les évêques catholiques suivent le droit romain, où c'est le consentement (souvent des parents) qui fait le mariage, tandis que les tribus germaniques suivent leurs droits propres, par lesquels c'est la relation sexuelle qui fait le mariage.
- 757 : le capitulaire de Compiègne dispose : « Si quelqu'un s'étant marié, trouve que son épouse n'est pas vierge, il a le droit de la renvoyer et de prendre une autre femme, mais si celle-ci n'est pas vierge, il ne pourra la renvoyer car lui non plus ne l'est pas ayant connu sa première femme » [citation douteuse].
- 1215 : au IVe concile de Latran, la qualité du mariage est mise en exergue comme l'un des sept sacrements et définie comme l'union de deux volontés plus que comme celle de deux corps. Le Concile impose donc le consentement des deux conjoints. Cela ne signifie pas qu'il n'y pas de mariages arrangés, mais que cela ne peut se faire sans une forme de consentements de la part de l'épouse. De fortes pressions sur les femmes ont eu lieu, spécialement dans le cas de mariages politiques et royaux.
- 1316, 1322 et 1328 : mise à l'écart de princesses de la succession royale et donc du trône de France, sans justification. Le déclenchement de la guerre de Cent ans, à la suite de l'alliance de deux fils de princesses éliminées (Charles de Navarre, le plus légitime, et Edouard III d'Angleterre, son cousin) qui contestent aux Valois le droit de régner, conduit à l'élaboration de la loi salique.
- 1405 : Christine de Pizan, première femme française de lettres à vivre de sa plume, dénonce dans La Cité des Dames la misogynie des clercs et s’insurge tant contre les discriminations dont les femmes sont victimes, que contre les propos de Jean de Meung sur elles, si opposés à ceux de Guillaume de Lorris.
- 1428-1430 : années d'activités militaires de Jeanne d'Arc.
XVIe siècle
- Se répand une légende à propos d'un Concile de Mâcon qui aurait débattu de l'existence d'une âme chez la femme. Un tel débat n'a en fait jamais eu lieu, les femmes ayant été baptisées aussi bien que les hommes dès les origines de la chrétienté, voire ayant été martyres pour cette raison, comme Blandine de Lyon. Il s'agissait en réalité de clarifier la distinction entre les termes « homo » (être humain) et « vir » (homme mâle), ce qui fut fait.
XVIIe siècle
- XVIIe siècle-XVIIIe siècle : Les femmes tiennent salon. Ces petits comités essentiellement masculins se réunissent souvent sous la protection de femmes qui leur garantissent une certaine liberté. Certaines femmes appartenant aux classes privilégiées se posent en effet en protectrices et rien, ou pas grand-chose, ne peut leur interdire une telle attitude. Ces « salons particuliers » reprennent la tradition des cercles des reines et des princesses à la cour qui émergent dès le XVe siècle. C'est dans le cadre de ces salons que les Lumières prennent leur essor en favorisant les libres débats.
- 1622 : Marie de Gournay réclame, dans son Égalité des hommes et des femmes, un meilleur accès à l’instruction pour toutes les femmes. Elle prend position dans le débat naissant sur la place de la femme, soutenant que celle-ci n’est pas inférieure à l'homme par nature mais du fait de son éducation.
- 1663 : Catherine Girardon, 1ère femme élue à l'Académie royale de peinture et de sculpture.
- 1674 : Madeleine de Scudéry, 1ère femme prix de l'éloquence de l'Académie française.
- 1681 : Mademoiselle de La Fontaine, 1ère femme danseuse professionnelle.
XVIIIe siècle
- 1713-1715 : Anne-Marguerite Petit du Noyer, 1ère femme journaliste connue au monde (pour sa couverture des traités d'Utrecht).
- 1724 : Création de la Bourse de Paris. La présence des femmes y est proscrite, et ce jusqu'en 1967.
- 1737 : Émilie du Châtelet, 1ère femme connue au monde à obtenir une publication scientifique.
- 6 juillet 1750 : dernière exécution publique française pour motif d'homosexualité, à Paris, en place de Grève. Jean Diot, un domestique de 40 ans, et Bruno Lenoir, un cordonnier de 23 ans, ont été arrêtés pour sodomie en janvier de la même année puis emprisonnés à la prison du Châtelet. Leurs biens sont confisqués. Condamnés à mort, ils sont étranglés puis brûlés.
- 1788-1789 : Convocation des États généraux pour la 22e fois en 488 ans (première en 1302). Les femmes veuves ou nobles tenant fief prennent part au vote mais elles ne sont pas directement éligibles. Elles peuvent toutefois être représentées par une sorte de suppléant comme c’est le cas notamment dans les assemblées locales. Les femmes prennent également une part très active à la rédaction des cahiers de doléances.
- 1789 : Les cahiers de doléances, préparés par le tiers-état, appellent un plan d'éducation national destiné à toutes les classes de la société, et demandent la création d'établissements pour les enfants abandonnés et vagabonds.
- 5 octobre 1789 : Marche des femmes de Paris à Versailles. Le roi et l'Assemblée doivent rejoindre Paris.
- 1790 : Condorcet plaide pour le droit de vote aux femmes dans son Admission des femmes au droit de cité : « Songez qu’il s’agit des droits de la moitié du genre humain ».
- 1790 : le droit d'aînesse masculin est supprimé par la loi. Tous les enfants sont désormais égaux devant la succession, quel que soit leur rang de naissance et leur sexe.
- 1791 : Olympe de Gouges réclame l’égalité politique entre hommes et femmes dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : « article 1. La femme naît libre et égale à l’homme en droits ». Elle est guillotinée deux ans plus tard, officiellement pour des écrits en faveur de Louis XVI.
- 1791 : Instauration du suffrage censitaire (environ 4,3 millions d’électeurs pour 40 000 personnes éligibles). Les femmes sont exclues du corps électoral.
- 2-17 mars 1791 : Le décret d’Allarde supprime les corporations et les privilèges de profession. Il proclame la liberté du travail, du commerce et de l’industrie.
- 14 juin 1791 : La loi Le Chapelier proscrit les groupements professionnels — en particulier les coalitions ouvrières — et les grèves.
- 25 septembre 1791 : dépénalisation de l’homosexualité dans le Code pénal ; néanmoins la loi ne la reconnaît pas pour autant (poursuites engagées sous d’autres incriminations comme l’outrage à la pudeur).
- 1792 : Le marquis de Condorcet présente un plan d'instruction publique car la pauvreté des familles les pousse davantage à faire travailler les enfants qu'à les envoyer à l'école.
- 11 août 1792 : Instauration du suffrage « universel » ; les femmes sont toujours exclues de la citoyenneté au même titre que les mineurs, les domestiques, les aliénés et les religieux cloîtrés.
- 20 septembre 1792 : instauration du mariage civil enregistré en mairie, qui devient le seul valable aux yeux de la loi. Cette loi permet aussi aux conjoints de rompre leur mariage, par consentement mutuel, pour « incompatibilité d’humeur ou de caractère » ou encore pour des causes imputables à un des époux (préfigurant le « divorce pour faute »).
- 1793 : Les femmes de Paris coiffées d’un bonnet rouge prennent d’assaut le Conseil général de la Commune de Paris, avec à leur tête, Claire Lacombe. Elles sont repoussées aux accents d’un discours clairement misogyne du procureur général Chaumette. Dans la foulée de ce coup de force, un décret de la Convention montagnarde interdit tous les clubs politiques de femmes.
- 1793 : Constitution de l'an I de la République. Une nouvelle Déclaration élargit la notion de droit à l'instruction, à l'assistance, etc.... Création d'un premier code civil qui affirme les devoirs des parents envers leurs enfants : "surveillance et protection".
- 20 août 1793 : définition du mariage par la Convention nationale : « Le mariage est une convention par laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union ».
- 1795 : La loi Lakanal institue une école pour 1000 habitants. Ainsi naît officiellement l'école laïque.
- 1795 : les femmes sont exclues de la vie politique. Tenaces, elles s’installent alors dans les travées réservées au public dans les différentes assemblées et ne manquent jamais une occasion pour émettre des avis en pleine délibération des législateurs. Ces femmes qui occupent littéralement les bancs du public sont vite taxées du nom de « tricoteuses », car nombre d’entre elles pratiquent effectivement le tricot en séance ou entre deux débats.
XIXe siècle
- 12 avril 1803 : La loi sur la réglementation du travail dans les manufactures et les ateliers réaffirme l’interdiction des coalitions ouvrières.
- 1er décembre 1803 : Instauration du livret ouvrier. Ce document, obligatoire, qui permet d’exercer un contrôle policier et patronal sur chaque travailleur, disparaîtra en 1890.
-
21 mars 1804 : promulgation
du Code civil, c’est-à-dire des règles qui déterminent le statut des personnes (livre
Ier), celui des biens (livre II) et celui des relations entre les
personnes privées (livres III et IV). Base juridique du droit
civil : droit de la famille, droit de la filiation, droit du couple,
etc…
La philosophie du Code civil pourrait se résumer dans la formule : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ». « Les concubins se passent de la loi : la loi se désintéresse d’eux » (Napoléon). L’épouse est une perpétuelle mineure, citée au nombre des incapables, en même temps que les enfants et les fous, tenue à un devoir d’obéissance, « obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider ».
En revanche, la veuve jouit, en théorie, de la plénitude de ses capacités juridiques, droit de vote exclu. En effet, la veuve ayant eu des enfants reste surveillée par un Conseil de famille composé de membres de la famille de son mari. Napoléon, en homme de son temps, n’est pas très sensible à la cause féministe et déclare « je n’aime pas les femmes qui se mêlent de politique »
Possibilité d’adopter des personnes majeures uniquement, afin de transmettre le patrimoine familial. - 21 mars 1804 : L’article 1781 du Code civil consacre l’infériorité légale de l’ouvrier face à l’employeur en stipulant qu’en cas de litige sur le salaire la parole du patron prime celle de l’ouvrier devant les tribunaux.
- 21 mars 1804 : conformément au code civil, l'enfant, mineur soumis à la puissance paternelle peut être enfermé sur simple demande de son père en vertu du « droit de correction paternelle ».
- 1804 : sociétés de secours mutuels pour les ouvriers.
- 18 mars 1806 : Création des conseils de prud’hommes, une juridiction chargée de régler les différends du travail. Les patrons y sont majoritaires.
- 1807 : Claude-Henri de Saint-Simon plaide pour le droit de vote des femmes.
- 1808 : Les filles et les femmes sont interdites dans l'enceinte des lycées .
- 1808 : Charles Fourier réclame le droit de vote des femmes et la liberté en amour.
- 20 février 1810 : Le code pénal soumet à l’autorisation gouvernementale toute association de plus de vingt personnes et qualifie la participation à une coalition ouvrière de délit.
- 1810 : Le Code pénal qualifie l'adultère de délit. L’adultère du mari est puni d’une amende, celui de la femme d’une peine de prison (de 3 à 24 mois).
- 1810 : selon l'article 317 du code pénal, l'avortement est un crime passible de la Cour d'assises (réclusion d'un an à cinq ans aussi bien la femme qui avorte que le tiers avorteur). Le praticien opérant l'avortement peut également se voir punir d'une amende et d'une interdiction d'exercer d'au moins cinq ans.
- 1810 : selon le code pénal, l’âge de la majorité pénale en matière criminelle et correctionnelle est fixé à 16 ans. Il subordonne la responsabilité pénale du mineur à la question du « discernement ».
- 1811 : les maisons centrales gérées par l'État prennent des dispositions pour séparer les enfants des adultes.
- 3 janvier 1813 : un décret impérial interdit le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines.
- 18 novembre 1814 : Loi imposant le repos dominical.
- 8 mai 1816 : interdiction du divorce.
- 18 avril et 29 septembre 1824 : ordonnances prescrivant la création de « maisons d'amendement », premiers établissements spécifiquement réservés à l'enferment des mineurs.
- 1829 : des quartiers sont réservés aux enfants dans les prisons départementales.
- 21 novembre-3 décembre 1831 : Révolte des Canuts à Lyon. La grève des ouvriers tisserands, astreints à dix-huit heures de travail par jour et dont les salaires ont fortement chuté, se transforme en insurrection. Le roi Louis-Philippe envoie une armée de 20 000 hommes pour mater le soulèvement.
- 1832 : Jusque-là délit, le viol est désormais un crime, mais c’est le père ou le mari qui est considéré comme lésé.
- 15 août 1832 : Fondation du journal La femme libre, premier journal féministe français, réalisé et publié uniquement par des femmes.
- 3 décembre 1832 : Par une circulaire, le comte d’Argout, ministre du commerce et des travaux publics, préconise de placer les enfants en apprentissage, plutôt que de les enfermer dans des prisons.
- Mai 1833 : Émeute des quatre sous, grève de mineurs du Nord considérée comme la première révolte à fort caractère social de l'époque pré-syndicale en France. Le procès des mineurs, qui furent poursuivis pour délit de coalition, eut un grand retentissement. 3 000 à 4 000 soldats occupèrent les corons et les fosses, face à 5 000 à 6 000 grévistes et installèrent 3 pièces d'artillerie pointées sur le carreau de la mine. Le 27, les mineurs reprirent le travail sans avoir rien obtenu.
- 1833 : Loi Guizot . L’historien et homme politique François Guizot légalise les écoles privées et oblige toute commune de plus de 500 habitants à avoir une école publique de garçons.
- 1834 : est institué le premier quartier réservé aux mineurs dans la prison de Strasbourg.
- 1835 : La militante socialiste Flora Tristan imagine dans son Nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères, la mise en place d’une structure d’accueil et de logement pour les femmes seules. Jusqu’à sa mort (1844), Flora Tristan est la voix par excellence du féminisme-socialisme pendant cette décennie pré-marxiste.
- 23 juin 1836 : l'ordonnance Pelet incite chaque commune à avoir au moins une école primaire pour filles.
- 1836 : la Petite Roquette, prison cellulaire pour mineurs à partir de sept ans jusque 20 ans, délinquants, vagabonds et enfants relevant de la correction paternelle, est ouverte.
- 1838 : première école normale d’institutrices.
- 1839 : de retour d’un voyage d’étude au Royaume-Uni, Flora Tristan avoue dans son Promenades dans Londres qu’« en France, de tradition, la femme y est l'être le plus honoré, en Angleterre, c'est le cheval ».
-
22 janvier 1840 : à l’initiative d’un ancien conseiller à la cour de Paris Auguste
Demetz, et grâce à un financement privé, est créée la
première colonie pénitentiaire à Mettray expérimentale pour les jeunes condamnés de l’article 66 (acquittés,
mais non remis à leurs parents).
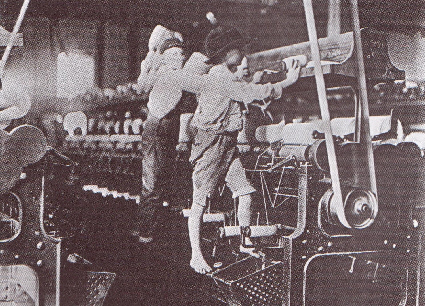
- 22 mars 1841 : Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers de moins de vingt ouvriers, interdisant notamment le travail au-dessous de l'âge de 8 ans, et limitant la journée de travail à huit heures pour les 8-12 ans et à douze heures pour les 12-16 ans. Le travail de nuit (de 9 heures du soir à 5 heures du matin) est interdit aux moins de 13 ans, et pour les plus âgés, deux heures comptent pour trois.
- 1841 : Création de l’inspection du travail des enfants en France.
- 1844 : Quelques jours avant son décès, Flora Tristan concède dans une lettre : « que j’ai tout le monde contre moi. Les hommes parce que je demande l’émancipation de la femme et les propriétaires parce que je demande celle des ouvriers ».
- 25 février 1848 : Au lendemain de la révolution parisienne, le gouvernement provisoire de la IIe République promulgue un décret garantissant le travail à tous les citoyens.
- 27 février 1848 : Ouverture des Ateliers nationaux — appelés aussi « ateliers de charité » —, créés par le gouvernement pour garantir un travail aux chômeurs et assurer leur encadrement.
- 28 février 1848 : Création de la commission du Luxembourg, considérée comme la première administration du travail en France. Composée d’ouvriers et de patrons, elle est notamment chargée de réfléchir à la question de l’« organisation du travail ».
- 2 mars 1848 : Décret limitant la journée de travail en usine à dix heures à Paris et onze en province. Le texte sera abrogé six mois plus tard, sous la pression patronale, et la journée de travail ramenée à douze heures partout en France.
- 5 mars 1848 : Deuxième République. Rétablissement du suffrage « universel » après un système censitaire, mais les femmes sont toujours exclues du droit de vote.
- 23-26 juin 1848 : Une révolte ouvrière éclate à Paris après la fermeture des Ateliers nationaux. Les forces de l’ordre massacrent plus de 4 000 insurgés.
- 1848 : Les Vésuviennes, femmes parisiennes qui avaient pris les armes lors de la révolution de 1848, revendiquent une Constitution politique des femmes, le port du pantalon l'accès à tous les emplois publics, civils, religieux et militaires. Ultra-radicales, les Vésuviennes desservent toutefois la cause féministe en réclamant des réformes comme l’obligation du mariage féminin à 21 ans, la mise en place d’un service militaire obligatoire féminin et le doublement du service militaire masculin pour les hommes qui refuseraient les tâches ménagères. La radicalité des Vésuviennes permet aux hommes hostiles à la cause féministe de s'en servir comme repoussoir. Autres féministes de 1848 : Désirée Gay, George Sand qui participent activement au gouvernement de la République. Jeanne Deroin, Eugénie Niboyet, Louise Colet et Adèle Esquiros sont à l’origine de deux journaux féministes : La Voix des Femmes puis L’Opinion des Femmes. Le journal lance la candidature surprise, et illégale, de George Sand. Cette dernière qui découvre sa candidature dans le journal s’en prend aux « suffragistes » car elle considère l’égalité politique comme secondaire.
- 1849 : Refusant le suffrage universel exclusivement masculin, Jeanne Deroin réclame le droit de vote pour les femmes et se présente aux élections législatives. Le socialiste Proudhon est l’un des plus virulents opposants à cette candidature féminine : « L'humanité ne doit aux femmes aucune idée morale, politique, philosophique. L'homme invente, perfectionne, travaille, produit et nourrit la femme. Celle-ci n'a même pas inventé son fuseau et sa quenouille ».
- 1850 : les premières compagnies privées de chemins de fer créent des caisses de retraite pour certains de leurs employés (création des régimes spéciaux)
- 1850 : Loi Falloux. Le comte Frédéric Alfred Pierre de Falloux instaure la liberté de l’enseignement secondaire entre le privé et le public. Celui-ci revient également sur les lois parues auparavant (Loi Guizot et Loi Pelet) en imposant aux communes de plus de 800 habitants à ouvrir et entretenir une école garçons comme de filles. Bien que réaménagée cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. La scolarité n'est cependant pas encore ni gratuite ni obligatoire.
- 5 août 1850 : loi entérinant la création et le développement des colonies agricoles sur le modèle de Mettray. Le financement devient public. Elle prévoit également dans son article 10 que les enfants de moins de 16 ans, condamnés à des peines de plus de 2 ans d'emprisonnement, seraient conduits dans une colonie plus répressive gérée par l'État. Ces établissements pénitentiaires recevaient également les enfants des colonies agricoles déclarés incorrigibles. Ce sont ces colonies que l'on qualifie aujourd'hui de "bagnes d'enfants".
- 1851 : le premier projet de loi proposant le droit de vote des femmes aux élections municipales voit le jour : il est dû à Pierre Leroux.
- 1851 : Marie-Angélique Duchemin, 1ère femme Chevalier de la Légion d'honneur.
- 1851 : Loi limitant la durée du travail : 10 heures avant 14 ans, 12 heures de 14 à 16 ans. Interdiction du travail de nuit pour les moins de seize ans et généralisation progressive de ces dispositions à tous les établissements.
- 26 mars 1852 : décret instituant les sociétés mutuelles, organisées sur une base territoriale et interprofessionnelle avec une forte implication des notables.
- 1er juin 1853 : Loi sur les conseils de prud’hommes supprimant le paritarisme et réduisant le corps électoral. La juridiction est placée sous le contrôle direct du pouvoir.
- 8 juin 1853 : Napoléon III généralise le régime de pension par répartition pour la fonction publique, l'âge normal de la retraite à cette époque étant de 60 ans (55 pour les travaux pénibles) et crée la pension de réversion.
- 1855 : premier collège d’enseignement libre féminin.
- 1855 : création de la colonie horticole de Saint Antoine à Ajaccio pour mineurs.
- 17 août 1861 : Julie-Victoire Daubié, première femme à obtenir le baccalauréat qu'elle a préparé seule.
- De 1861 à 1896 : 299 femmes seulement obtiennent le baccalauréat.
- 1862 : Élisa Lemonnier crée la Société pour l'enseignement professionnel des femmes et ouvre plusieurs écoles professionnelles (commerce, couture, arts industriels de luxe, musique) pour les jeunes filles
- 19 avril 1863 : Emma Chenu est la deuxième femme à obtenir le baccalauréat.
- 17 février 1864 : Le « Manifeste des soixante », signé et publié par soixante ouvriers de la Seine, réclame une représentation ouvrière au Parlement et appelle à la constitution d’un mouvement syndical autonome.
- 25 mai 1864 : Abolition du délit de coalition par la Loi Ollivier et reconnaissance du droit de grève, sauf en cas de violence et d’atteinte à la liberté du travail.
- 15 avril 1867 : La loi Duruy impose aux communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école de filles rejoignant les standards masculins, et réorganise le programme de l'enseignement primaire féminin qui devient national.
- juillet 1868 : Emma Chenu devient la première à obtenir une licence en France, elle est licenciée ès sciences.
- 1868 : Abrogation de l’article 1781 du Code civil qui consacrait l’infériorité légale du salarié face à l’employeur.
- Juillet 1868 : Création de deux caisses d’assurance facultatives, l’une sur la vie, l’autre contre les accidents du travail.
- 18 mars-27 mai 1871 : Pendant la Commune de Paris, d’importantes mesures sociales sont édictées par le gouvernement insurrectionnel : un « prix minimum du travail » et l’égalité des salaires entre hommes et femmes sont instaurés, ainsi que l’abolition du travail de nuit des ouvriers boulangers, l’interdiction des amendes et des retenues sur salaires, etc.
- 28 octobre 1871 : Julie-Victoire Daubié est la première licenciée ès lettres, à l'époque où les cours à la Sorbonne ne sont pas ouverts aux femmes.
- 17 mars 1872 : La loi Dufaure punit d’une peine de prison toute organisation « ayant pour but de provoquer à la suspension du travail, à l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la religion ».
- 24 avril 1872 : Ouverture d’une enquête parlementaire sur les conditions de travail en France.
- 19 mai 1874 : Création de l’inspection du travail. Loi interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans (sauf exception) dont le temps de travail est limité à six heures par jour ; le travail de nuit pour les filles mineures et pour les garçons de moins de 16 ans. Le repos du dimanche devient obligatoire pour les ouvriers âgés de moins de 16 ans.
- 1874 : Le travail des femmes est interdit dans les mines et les carrières. Joséphine Andrée, syndicaliste fonde le Syndicat féminin de la couture, premier syndicat féminin.
- 1875 : la Constitution de la IIIe République confirme la privation de droits politiques pour les femmes.
- 1875 : Madeleine Brès, 1ère femme française à obtenir un doctorat en médecine (elle a été précédée en France par l'anglaise Elizabeth Garrett Anderson en 1870 et l'américaine Mary Corinna Putnam en 1871 qui sont entrées à la faculté de médecine la même année que Madeleine, en 1868. Reflétant le sentiment général de la communauté universitaire et médicale, le docteur Henri Montanier écrit en 1868 dans la Gazette des hôpitaux (n° 42, p. 34-35) : « pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes (...) Lorsque la femme en serait arrivée là, je me le demande, que resterait-il de la femme ? Un être qui ne serait plus ni une jeune fille ni une femme ni une épouse ni une mère ! ). Sa thèse, qui traitait de la composition du lait maternel, obtint la mention « extrêmement bien ».
- 1876 : Hubertine Auclert, journaliste et première suffragette, fonde l’association Le Droit des femmes, groupe suffragiste qui devient Le Suffrage des femmes en 1883, et se bat pour l’égalité politique. Lors du congrès de Marseille, elle proclame : « Qui dit droit, dit responsabilité, la femme doit travailler, n'étant pas moins tenue de produire que l'homme, vu qu'elle consomme… qu'il y ait pour les deux sexes même facilité de production, et application rigoureuse de cette formule économique : à production égale, salaire égal ».
- 18 mars 1877 : création du livret de famille (à la suite de la destruction totale de l'état civil parisien en 1871).
- 1878 : Juliette Dodu, 1ère femme à recevoir la Légion d'honneur à titre militaire.
- 1879 : Loi Paul Bert rend obligatoire l'entretien d'une École normale de jeunes filles dans chaque département français.
- 1880 : Accès des femmes aux universités. La Sorbonne s'ouvre aux jeunes filles.
- 7 février 1880 : Réforme des conseils de prud’hommes et mise en place de la parité effective de représentation.
- 12 juillet 1880 : Abrogation de l'obligation du repos dominical.
-
29 mai 1880
: bagnes pour enfants créés à Belle-Île.
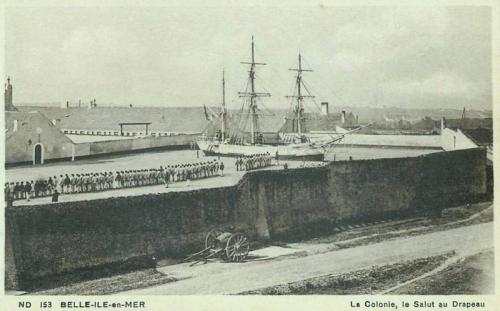
- 21 décembre 1880 : Loi Camille Sée organisant l’enseignement secondaire pour jeunes filles ; les programmes sont spécifiques (pas de latin ni grec, ni philosophie) ; l'enseignement dure 5 ans au lieu de 7 ; il n'est pas sanctionné par le bac et ne permet pas d'entrer à l'université .
- 1881 : Création de l’école normale supérieure de Sèvres pour former les professeurs de sexe féminin.
- 1881 : Blanche Edwards est reçue au concours de l'externat en médecine. Des étudiants brûlent son effigie boulevard St Michel.
- 13 février 1881 : Hubertine Auclert lance le journal La Citoyenne, journal féministe publié à Paris jusqu'en 1891.
- De 1881 au 28 mars 1882 : Lois Jules Ferry. L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes de six ans révolus à treize ans révolus et organise un enseignement laïque et gratuit.
- 14 janvier 1882 : Maria Deraismes, 1ère femme, avec la complicité active du docteur Georges Martin, à être initiée dans la loge franc-maçonnique « Les Libres-Penseurs » à l'Orient du Pecq.
- octobre 1882 : Blanche Edwards-Pilliet, 1ère française externe des hôpitaux.
- 1883 : Lucie Aron, 1ère femme agrégée de sciences.
- 1884 : Clémence Royer, femme de sciences, donne des cours à la Sorbonne ; Dorothea Klumpke, 1ère française docteure en géographie.
- février à avril 1884 : la Grande grève des mineurs d'Anzin regroupe plus de 10 000 grévistes pendant 56 jours, sans succès. Répercutée par la presse, elle a un retentissement national. C'est à cette occasion qu'Émile Zola vient se documenter à Anzin pour son roman Germinal.
- 21 mars 1884 : Loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats professionnels mais imposant le dépôt des statuts et du nom des administrateurs.
- 27 juillet 1884 : Loi Naquet rétablissant le divorce dans sa version la plus restrictive (divorce pour faute uniquement).
- 1885 : premières institutrices laïques.
- 1885 : Blanche Edwards-Pilliet et Augusta Dejerine-Klumpke, 1ères femmes inscrites au concours de l'internat des hôpitaux de Paris, malgré la pétition signée par 90 médecins et internes contre cette inscription; Liouba Bortniker, 1ère femme agrégée de mathématiques ; Séverine, 1ère femme au monde directrice de publication d'un quotidien.
- 1886 : Augusta Dejerine-Klumpke, 1ère femme à être reçue au concours de l'internat des hôpitaux de Paris.
- 1886 : Création de la Fédération nationale des syndicats (FNS), d'inspiration guesdiste. Jules Guesde, l'un des socialistes les plus connus et les plus actifs, contribue à la diffusion des idées de Karl Marx en France.
- 3 février 1887 : Inauguration de la première Bourse du travail à Paris.
- 1887 : Création du Syndicat des employés du commerce et de l’industrie (SECI), syndicat chrétien, précurseur de la CFTC.
- 1888 : International : création du Conseil international des femmes (CIF ou ICW en anglais).
- 1888 : Louise-Amélie Leblois, 1ère femme docteure ès sciences.
- 1889 : loi fonctionnarisant les instituteurs et les institutrices.
- 1889 : Paul Robin, pédagogue libertaire, crée à Paris le premier centre d'information et de vente de produits anticonceptionnels.
- 1890 : Sarmiza Bilcescu, 1ère femme docteure en droit.
- 1er mai 1890 : première célébration du premier mai en France
- 1890 : Disparition du livret ouvrier qui permettait d’exercer un contrôle policier et patronal sur chaque travailleur.
- 27 décembre 1890 : La loi sur le contrat de louage modifie la réglementation du code civil sur le contrat d’embauche dans un sens plutôt favorable aux salariés.
-
1er mai 1891
: première célébration française et internationale de la journée d'action
du 1er mai. Le 1er mai 1891, Fusillade de Fourmies (Nord) la troupe tire sur des grévistes : neuf
morts
- Maria Blondeau, 18 ans
- Louise Hublet, 20 ans
- Ernestine Diot, 17 ans
- Félicie Tonnelier, 16 ans
- Kléber Giloteaux, 19 ans
- Charles Leroy, 20 ans
- Émile Ségaux, 30 ans
- Gustave Pestiaux, 14 ans
- Émile Cornaille, 11 ans,
- 29 novembre 1891 : La première convention collective est conclue à Arras entre organisations syndicales et patronales, après un mouvement de grève des mineurs des houillères du Nord le 16 novembre.
- décembre 1891 : Maria Martin crée le Journal des femmes, qui parait jusqu'en 1911.
- 7-8 février 1892 : Congrès constitutif de la Fédération nationale des bourses du travail à Saint-Etienne. Objectif : assurer un secours aux accidentés du travail et aux chômeurs, et organiser la solidarité ouvrière lors des grèves.
- 1892 : Création d’un corps unique d’inspecteurs du travail d’État en France.
- 1892 : Le port du pantalon interdit pour les femmes depuis le Directoire, est désormais possible à condition qu’elles tiennent à la main une bicyclette ou un cheval (cette loi n'a été abrogée qu'en 2013 mais était tombée en désuétude).
- 2 novembre 1892 : Par cette loi, il est interdit d’embaucher les enfants de moins de 13 ans, la durée maximale de travail est ramenée à 10 heures quotidiennes à 13 ans, à 60 heures hebdomadaires entre 16 et 18 ans à raison de six jours par semaine, et un certificat d'aptitude est nécessaire.
- 2 novembre 1892 : Réforme de la loi du 19 mai 1874. La journée de travail est fixée à onze heures pour les femmes et douze heures pour les hommes, à raison de six jours par semaine.
- 27 décembre 1892 : Loi organisant une procédure facultative de conciliation et d’arbitrage dans les conflits sociaux entre patrons et salariés. Elle ne sera pratiquement jamais appliquée.
- 1893 : Loi sur l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels.
- 1893 : Maria Deraismes, 1ère femme fondatrice d'une loge maçonnique, « Le Droit humain ».
- 15 juillet 1893 : Loi sur l'assistance médicale.
- 29 juin 1894 : loi instituant un système de retraite et de caisses d’assurance-maladie pour les mineurs financé par les patrons et garanti par l'État.
- 17-22 septembre 1894 : A Nantes, le congrès de la Fédération nationale des syndicats adopte le principe de la grève générale et de la rupture avec les partis politiques.
- 1895 : Rosa Bonheur, 1ère femme Officier de la Légion d'honneur.
- 23 septembre 1895 : Création de la Confédération générale du travail (CGT) au congrès ouvrier de Limoges.
- 1896 : Alice Guy, 1ère femme au monde réalisatrice de cinéma (pour La Fée aux choux).
- 1897 : Henriette Mazot, 1ère femme interne en pharmacie ; Marie Kapsevitch, 1ère femme diplômée vétérinaire.
- 1897 : les travailleurs des arsenaux et de l’armement obtiennent, dans un cadre obligatoire, l’assurance maladie et un régime de retraite.
- 1897 : Les femmes peuvent désormais témoigner dans les actes d'état-civil, et dans les actes notariés.
- 9 décembre 1897 : Fondation du journal quotidien féministe La Fronde par Marguerite Durand. Ce fut un quotidien jusqu’en 1903, puis un mensuel jusqu’en 1905.
- 1898 : la loi permet désormais aux femmes d'être électrices au Tribunal de commerce.
- 1er avril 1898 : « Charte de la mutualité » créant un système mutualiste libéral, en mettant fin au contrôle de l'administration sur les sociétés de secours mutuels.
- 9 avril 1898 : Loi sur les accidents du travail, créant un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et établissant la responsabilité patronale. Elle sera étendue aux maladies d’origine professionnelle en 1919.
- 12 mai 1898 : Duchesse d'Uzès, 1ère femme titulaire d'un permis de conduire.
- 1898 : Une loi institue la répression des violences, des voies de fait, actes de cruautés et atteintes commis envers les enfants.
- 1898 : loi permettant de remettre à l'Assistance publique les enfants ayant été reconnus coupables d'un crime ou d'un délit.
- 1898 : création d'une colonie pénitentiaire pour mineurs à Eysses.
XXe siècle
- 1900 : Ouverture aux femmes de l'École des Beaux-Arts.
- 1er décembre 1900 : Loi ouvrant, à la suite de pressions féministes, le barreau aux femmes avec accès à la plaidoirie, exercice jugé viril par excellence, et suscitant une réaction misogyne importante aussi bien au Palais de Justice que dans le public. Certains juristes, comme le juge Paul Magnaud, applaudissent cependant à cette entrée des femmes dans la profession, espérant même qu'elles pourraient bientôt devenir magistrates.
- 6 et 7 décembre 1900 : Sonia Olga Balachowski-Petit & Jeanne Chauvin, 1ères femmes avocates.
- 30 mars 1900 : Loi Millerand sur la limitation de la journée de travail pour tous les salariés : onze heures dans un premier temps, puis dix heures trente en 1902 et dix heures en 1904.
- 1901 : Première proposition de loi accordant le droit de vote aux femmes majeures, célibataires, veuves ou divorcées, mais pas aux femmes mariées (dont on ne pourrait être sûr qu'elle vote comme le voudrait leur mari).
- 1901 : Jeanne Chauvin, 1ère femme avocate au monde à plaider lors de l'affaire de la catastrophe ferroviaire de Choisy-le-Roi ; Clémence Royer, 1ère femme à recevoir la Légion d'honneur à titre scientifique.
- 18 avril 1901 : Création du Conseil national des femmes françaises, affilié au Conseil international des femmes, association féminine non mixte, visant à améliorer la situation des femmes dans la famille et la société, travaillant étroitement avec les institutions.
- 1902 : Julia Morgan, 1ère femme élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts ; Julia Morgan, 1ère femme diplômée en architecture (Beaux-arts de Paris).
- 1903 : Adrienne Avril de Sainte-Croix, 1ère femme membre d'une commission extra-parlementaire (par le gouvernement Émile Combes) ; Marguerite Dilhan, 1ère femme avocate à plaider en cour d'assises ; Marie Curie, 1ère femme au monde récipiendaire d'un Prix Nobel (spécifiquement du Prix Nobel de physique).
- 1904 : loi revenant sur celle de 1898, en permettant à l'Assistance publique des mineurs qui lui ont été confiés, même s'ils n'ont pas commis de délit, de remettre l'enfant à l'administration pénitentiaire.
- 1905 : Jeanne Baudry, 1ère femme agrégée de philosophie.
- 1905 : Une loi autorise l'enfant qui travaille à saisir les juges de paix en ce qui concerne ses conditions de travail.
- 1906 : Le couturier Paul Poiret supprime le corset, en créant des robes taille haute. Il devient ainsi un pionnier de l'émancipation féminine.
- 1906 : Madeleine Pelletier, 1ère femme médecin diplômée en psychiatrie ; Marie Curie, 1ère femme chaire à la Sorbonne (physique) ; Geneviève Aclocque, 1ère femme élève de l'École nationale des chartes ; Isabelle Bogelot, 1ère femme nommée au Conseil supérieur de l'assistance et de l'hygiène publique, grâce au travail du Conseil national des femmes françaises.
- 13 juillet 1906 : Rétablissement du repos dominical pour les employés et les ouvriers. Le dimanche est le jour légal de repos.
- 25 octobre 1906 : Création du ministère du Travail et de la prévoyance sociale.
- 1906 : alors que la presse dénonce les apaches, le seuil de la minorité pénale est relevé de 16 à 18 ans. Mais cette loi n'est libérale qu'en apparence : les mineurs de 16 à 18 ans, reconnus discernant, encourent les mêmes peines que les adultes. Des mineurs qui ne risquaient que quelques jours de prison, pour vagabondage ou mendicité, risquent désormais la maison de correction jusqu'à 21 ans. Cela suscite un mouvement de protestation chez les jeunes prostituées qui encouraient alors l'internement à l'Hospice des Enfants Assistés de Saint-Lazare .
- 1907 : Marie Robert, 1ère femme agrégée de sciences naturelles.
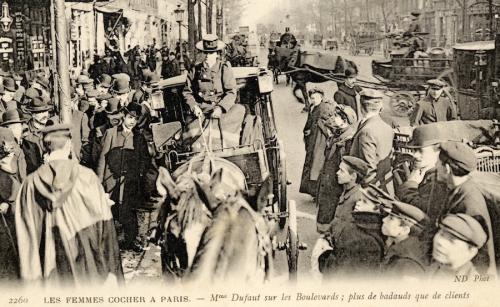 15 février 1907 : Amélie Duffaut et Mme Charnier, 1ères femmes cochères (« Pourquoi pas de femmes cochères ? Il y a des milliers d'années qu'elles conduisent les hommes ; pourquoi ne conduiraient-elles pas des chevaux ? », s’amuse pour sa part Le Journal amusant).
15 février 1907 : Amélie Duffaut et Mme Charnier, 1ères femmes cochères (« Pourquoi pas de femmes cochères ? Il y a des milliers d'années qu'elles conduisent les hommes ; pourquoi ne conduiraient-elles pas des chevaux ? », s’amuse pour sa part Le Journal amusant). - 17 mars 1907 : La réforme des conseils de prud’hommes prévoit l’élection de délégués, tant du côté patronal que pour les salariés, et un fonctionnement paritaire.
- 17 mars 1907 :
 La loi permet aux femmes d'être électrices et éligibles aux tribunaux de prud'hommes.
La loi permet aux femmes d'être électrices et éligibles aux tribunaux de prud'hommes. - 25 mars 1907 : Sophie Berthelot, 1ère femme entrée au Panthéon (en vertu d'être l'épouse de Marcellin Berthelot).
- 21 juin 1907 : liberté de mariage et du choix du conjoint : fin de l’obligation du consentement des parents par des «actes respectueux».
- 13 juillet 1907 : Loi sur la protection du salaire féminin : une femme mariée exerçant une profession distincte de celle de son époux peut désormais disposer librement de son salaire. C’est l’une des premières réformes qui entame la puissance absolue du mari. Cette loi a été ardemment défendue par Jeanne Chauvin, première femme à exercer le métier d’avocate en France. Ses plaidoiries feront évoluer le droit de la famille.
- 1908 : Clémence Jusselin, 1ère femme élue au conseil des prud'hommes.
- avril 1908 : Mme Decourcelle, 1ère femme titulaire d'un permis de taxi (chaufferesse).
- 1909 : Les salaires des instituteurs et des institutrices deviennent égaux. — Grande manifestation à Paris pour le droit de vote des femmes. — Création de l'Union française pour le suffrage des femmes. — Rappel de la circulaire de 1892 : Le port du pantalon n'est plus un délit si la femme tient un guidon de bicyclette ou les rennes d'un cheval. Dans les faits, l'usage se répand dès les années 1920 pour devenir courant dans les années 1960.
- 26 mars 1909 : Les députés votent l’interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires.
- 1909 : Lily Laskine, 1ère femme instrumentiste titulaire-remplaçante à l'orchestre de l'Opéra de Paris (harpe) ; Yvonne Lacroix, 1ère femme championne de patinage artistique.
- 1909 : assurance maladie et régime de retraite pour tous les cheminots.
- 24 novembre 1909 : la loi Engerand institue un congé de maternité d'une durée de huit semaines, avant et après l'accouchement, sans rémunération mais sans rupture du contrat de travail.
- 1910 : Judith Gautier, 1ère femme jurée à l'académie Goncourt.
- 1910 : les institutrices obtiennent le maintien du traitement en cas de congé de maternité.
- 1910 : Le rapport Buisson propose à la Chambre des députés le droit de vote et d'éligibilité des femmes.
- 8 mars 1910 : Élise Deroche, 1ère femme (en France et dans le monde) titulaire d'un brevet de pilote d'avion ; Marguerite Rouvière, 1ère femme élève de l'École normale supérieure (sciences).
- 5 avril 1910 : loi sur les retraites ouvrières et paysannes, créant des systèmes de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire. L’âge de la retraite est fixé à 65 ans. La CGT qualifie le dispositif d’« escroquerie » (l’espérance de vie est à l’époque de moins de 49 ans).
- 28 décembre 1910 : Loi portant codification des lois ouvrières et instituant le code du travail, qui rassemble toutes les avancées de la législation sociale.
- 1911 : Au sein du syndicat CGT des employés, création d'une section féminine.
- 1911 : Les employées des PTT obtiennent la rémunération de leur congé maternité.
- 1911 : Lucienne Heuvelmans, 1ère femme Prix de Rome en sculpture & pensionnaire de la villa Médicis ; Marie Curie, 1ère femme au monde récipiendaire d'un Prix Nobel de chimie & à être récompensée de deux Prix Nobel.
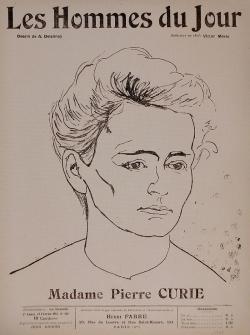
- 1912 : Jeanne Raison, 1ère femme agrégée de grammaire ; Edmée Chandon, 1ère femme astronome professionnelle.
- 1912 : loi instituant les tribunaux pour enfants et distinguant 3 classes de mineurs (moins de 13 ans, 13 à 16, et 16 à 18 ans). La circulaire du 30 janvier 1914 affirme le principe de pénalisation des délits commis par les mineurs de 13 ans, qui ne sont toutefois pas punissables.
- 16 novembre 1912 : autorisation de recherche juridique de paternité naturelle, en vue de l’établissement de la filiation, dans un certain nombre de cas très restrictifs : enlèvement, viol, « séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles », l’aveu écrit non équivoque de paternité, le concubinage notoire et enfin l’entretien de l’enfant par le père prétendu.
- 1913 : Marguerite Rouvière, 1ère femme agrégée de sciences physiques ; Claudette Coste, 1ère femme présidente d'un conseil de prud'hommes ; Lili Boulanger, 1ère femme Prix de Rome en musique.
- 1913 : Création de l'association internationale pour la protection de l'enfance.
- 12 juin 1913 : la loi Strauss accorde un congé de maternité de quatre semaines après l'accouchement, avec une faible indemnité journalière.
- 1914 : Jeanne Duportal, 1ère femme docteure ès lettres ; Léontine Zanta, 1ère femme docteure en philosophie.
- 1915 : La modiste Coco Chanel raccourcit les jupes et supprime la taille. Elle conçoit aussi des vêtements pour les femmes, simples et pratiques, dont l’esthétique s’inspire d'une vie dynamique et sportive qui aime jouer avec les codes féminins-masculins.
- 1915 : Sophie Germain, 1ère femme récompensée du prix de l'Institut de France pour ses travaux (sous pseudonyme masculin) sur les vibrations de structures élastiques.
- 13 janvier 1915 : La France est en guerre depuis six mois. Le socialiste Albert Thomas, sous-secrétaire d’Etat de l’artillerie et des munitions, déclare : « Il n’y a plus de droits ouvriers, plus de lois sociales, il n’y a plus que la guerre. »
- 1918 : L'École Centrale est ouverte aux femmes.
- 1918 : Marie de Regnier, 1ère femme Prix de littérature de l'Académie française.
- 1918 : Europe : La plupart des Européennes obtiennent entre 1918 et 1920, partiellement ou intégralement, (Royaume-Uni, Russie soviétique, Pologne, Tchécoslovaquie en 1918, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Suède en 1919, Albanie, Autriche et Hongrie en 1920), le droit de vote.
- 1919 : Yvonne Pouzin, 1ère femme praticien hospitalier.
- 1919 : La Chambre des députés adopte une proposition de loi pour le vote des femmes, par 329 voix contre 95 : proposition refusée par le Sénat. — Remise à Georges Clemenceau président de la Conférence de paix de Paris d'une pétition de cinq millions de femmes américaines contre le viol de guerre. Elle n'aura pas de suites. — L'École supérieure de chimie de Paris et l'École supérieure d'électricité s'ouvrent aux jeunes filles.
- 25 mars 1919 : Instauration des conventions collectives, destinées à fixer les salaires, l’organisation de la journée de travail, etc.
- 23 avril 1919 : La journée de travail est ramenée à huit heures, sans diminution de salaire, dans tous les établissements industriels et commerciaux. La journée du 1er mai devient officiellement une journée chômée.
- 28 juin 1919 : Le traité de Versailles institue l’Organisation internationale du travail (OIT), qui a pour but officiel d’améliorer les conditions de travail dans le monde et le niveau de vie des salariés.
- 28 juin 1919 : Création par la Société des Nations, à Genève, du Comité de protection de l'enfance.
- 1er novembre 1919 : Création de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
- 1920 : Marie Buffet, 1ère femme diplômée de l'École centrale.
- 15 juillet 1920 : Les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari.
- 31 juillet 1920 : dans le contexte de la politique nataliste à la suite de la Première Guerre mondiale, la loi réprime fortement l'avortement (défini comme un crime) et interdit la propagande pour les méthodes anticonceptionnelles.
- 1921 : Dora "Dörchen" Richter (1891–1933), une Allemande, a été la première personne connue à subir une opération de réattribution sexuelle masculin-féminin complète.
- 1922 : Marie Curie, 1ère femme membre de l'Académie de médecine ; Marie-Rose Bouchemousse, 1ère femme docteur en philosophie scolastique à l'Institut Catholique de Paris.
- 1923 : Marthe Condat, 1ère femme agrégée de médecine ; Madeleine Deries, 1ère femme docteur en histoire ; Jeanne Surugue, 1ère femme diplômée des Beaux-Arts.
- 27 mars 1923 : le code pénal fait de l'avortement un délit, afin de mieux poursuivre les avorteurs et avortées devant les cours d'assises.
- 19 juin 1923 : possibilité d’adopter les enfants mineurs orphelins, pour permettre l’adoption des orphelins de guerre.
- 1924 : Suzanne Belperron, 1ère femme joaillière, codirectrice de la maison Boivin.
- 23 mars 1924 : Création d’un ministère du travail, de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociales, premier grand ministère des affaires sociales.
- 25 mars 1924 : Le Décret Bérart institue des horaires et des programmes d'études identiques dans les établissements secondaires de garçons et de filles, ce qui créé l'équivalence entre les baccalauréats masculin et féminin.
- 26 septembre 1924 : La Déclaration de Genève. Première tentative de codifier les droits fondamentaux des enfants par l'Union Internationale de secours aux enfants (UISE).
- 1925 : Odette Pauvert, 1ère femme Prix de Rome en peinture ; Renée David, 1ère femme verbicruciste.
- 11 avril 1925 : Création de l'École polytechnique féminine.
- 1925 : La Chambre des députés adopte par 389 voix contre 140 une proposition de loi instaurant le vote des femmes lors des élections municipales et cantonales. Des candidates communistes sont élues aux municipales. Mme Variot siège par exemple au conseil municipal de Malakoff. Ces élues sont finalement écartées par les tribunaux.
- mai 1925 : Joséphine Pencalet, 1ère femme candidate sur une liste lors d'une élection municipale (présentée par le PCF, après une directive de Moscou), élue dès le 1er tour, mais en novembre 1925, le Conseil d'État invalide son élection au motif qu'elle est une femme. La jeune femme, pleine d'amertume pour ce système qui finalement l'a utilisée, ne votera plus jusqu’à sa mort en 1972.
- 25 septembre 1925 : Le gouvernement reconnaît aux fonctionnaires le droit de se syndiquer.
- 1926 : Tour de France suffragiste de Marthe Bray.

- 20 avril 1926 : le gouvernement officialise la Fête des mères dans le cadre de la politique nataliste encouragée par la République.
- 7 décembre 1926 : loi interdisant l'affectation des enfants aux travaux dangereux.
- 1927 : Élisabeth Odier-Dollfus, 1ère femme cheffe de clinique titulaire ; Simone Pétrement, Clémence Ramnoux et Suzanne Roubaud, 1ères femmes élèves de l'École normale supérieure (lettres).
- 1927 : Les employés des deux sexes des PTT, de la Caisse des Dépôts et Consignations, et les professeurs du secondaire à niveau de diplôme égal ont désormais le même traitement. — Une Française mariée à un étranger conserve sa nationalité. — L’Assemblée vote une quatrième fois en faveur du droit de vote aux femmes par 396 voix contre 94. Le Sénat fait barrage.
- décembre 1927 : bagnes pour enfants rebaptisés en « maison d'éducation surveillée »
- 1928 : institution de l'assurance-maternité, qui indemnise la moitié de la perte de salaire. Le congé maternité est porté à 12 semaines. Le congé de maternité de huit semaines, avec maintien du traitement, est étendu à toute la fonction publique.
- 5 avril 1928 : loi légèrement corrigée par celle du 30 avril 1930, garantissant au retraité qui a atteint l'âge de 60 ans et qui peut justifier de 30 années d'affiliation, une pension qui se monte à 40 % du salaire moyen sur la période de cotisation. Le salarié a la possibilité d'ajourner à 65 ans la liquidation de sa retraite.
- 1929 : Lucie Randoin, 1ère femme professeure à la faculté de médecine de Paris ; Isabelle Plancke, 1ère femme à réussir le brevet de maître-nageur.
- décembre 1929 : Madeleine Blocher-Saillens, 1ère femme pasteure protestante.
- 1930 : Lili Elbe a été une des premières femmes transgenres bénéficiaires de la chirurgie de réattribution sexuelle, en Allemagne. Elle a subi cinq chirurgies : la pénectomie et l'orchiectomie, la transplantation d'ovaires, deux opérations pour enlever les ovaires, après le rejet de greffe, et la vaginoplastie. Cependant elle est décédée trois mois après sa cinquième opération.
- 1930 : Les femmes peuvent être juges.
- 1930 : Thérèse Bertrand-Fontaine, 1ère femme médecin des hôpitaux de Paris ; Jeanne Miquel, 1ère femme diplômée à l'École vétérinaire ; Suzanne Borel, 1ère femme reçue au concours d'admission aux carrières diplomatiques ; Jacqueline de Romilly
(alors Jacqueline David), 1ère femme lauréate du concours général (du lycée Molière, à Paris) ; Germaine Beaumont, 1ère femme Prix Renaudot (pour Piège) ; Jane Evrard, 1ère femme cheffe d’orchestre ; Germaine Cellier, 1ère femme nez. - 30 avril 1930 : Adoption de la loi sur les assurances sociales pour les salariés les plus modestes de l’industrie et du commerce. Le dispositif couvre les risques de maladie, maternité, chômage, invalidité, vieillesse et décès.
- 1931 : Anna de Noailles, 1ère femme Commandeur de la Légion d'honneur.
- 1932 : La Chambre des députés vote par 446 voix contre 60 une résolution invitant le gouvernement à faire pression sur le Sénat afin de rendre possible l’adoption du texte sur le droit de vote aux femmes. Sans suites.
- 1932 : Suzanne Basdevant, 1ère femme agrégée de droit public.
- 11 mars 1932 : L’affiliation aux caisses d’allocations familiales, financées par les entreprises, devient obligatoire.
- 1933 : Me le Quéméner, 1ère femme commissaire-priseur (à Lorient) ; Eugénie Brazier & Marie Bourgeois, 1ères femmes trois étoiles au guide Michelin ; Ginette Hamelin, 1ère femme diplômée ingénieur architecte de l'École des Travaux Publics ; Paule-René Pignet, 1ère femme bâtonnier (à La Roche-sur-Yon).
- 1934 : Une célèbre révolte des enfants fait connaître au monde entier les conditions de détention au bagne de Belle-Ile qui sont améliorées.
- 1935 : La Chambre des députés se prononce pour la cinquième fois pour le vote des femmes par 453 voix contre 124. À nouveau, le Sénat bloque.
- 1935-1936 : Plusieurs communes organisent des scrutins parallèles mixtes aboutissant à faire élire des conseillères municipales supplémentaires ; à Louviers, dont le maire est Pierre Mendès France, six conseillères sont ainsi élues et siègent avec voix consultative.
- 1936 : Lucienne Scheid, 1ère femme élue première secrétaire de la Conférence du stage.
- avril 1936 : 1ères femmes membres d'un gouvernement : Cécile Brunschvicg (sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale), Irène Joliot-Curie (sous-secrétaire d'État à la Recherche scientifique) et Suzanne Lacore (sous-secrétaire d'État à la Protection de l'enfance).
- Nuit du 7 au 8 juin 1936 : Accords Matignon signés entre le gouvernement de Front populaire, le patronat et la CGT : semaine de quarante heures, congés payés de quinze jours annuels, droit de se syndiquer librement, instauration du délégué du personnel, augmentation des salaires de 7 à 12%, loi sur les convention collective de travail.
- 30 juillet 1936 : la Chambre des députés se prononce pour la sixième et dernière fois pour le vote des femmes par 495 voix contre 0. Le gouvernement s'abstient. Le Sénat n'inscrira jamais ce texte à son ordre du jour.
- 9 août 1936 : scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans.
- 1936 : Réforme de la banque de France.
- 1936 : Mise en place du billet de congé annuel.
- 31 décembre 1936 : Loi sur la conciliation et l’arbitrage obligatoire des conflits du travail.
- 1937 : les femmes sont autorisées à enseigner le latin, le grec et la philosophie. — Les femmes mariées peuvent obtenir un passeport sans l’autorisation de leur mari.
- 1938 : Yvonne-Edmond Foinant, 1ère femme à être élue déléguée à la Confédération Générale du Patronat français (actuel Medef) ; Marie Ventura, 1ère femme metteuse en scène à la Comédie-française (Iphigénie de Jean Racine).
- 18 février 1938 : Suppression de l’incapacité civile ; les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation de leur mari.
- 18 février 1938 : Suppression de la puissance maritale : l'article 213 du Code Civil de 1804 est réformé et supprime l'incapacité juridique des femmes. Elles ne doivent plus obéissance à leur époux.
- 12-15 novembre 1938 : Le gouvernement Daladier promulgue une série de décrets-lois qui « aménagent » la loi sur les quarante heures (retour à la semaine de six jours).
- 29 juillet 1939 : Création de brigades policières chargées de traquer les « faiseuse d'anges ». La répression contre l’avortement et la contraception s'accroît. Une prime à la première naissance est créée. Arrestation de Madeleine Pelletier, une féministe qui défend le droit à l'avortement et qui est menée à l'asile, où elle meurt six mois plus tard.
- 1er septembre 1939 : Le décret-loi « fixant le régime du travail » suspend la législation sur la conciliation et l’arbitrage.
- 1940 : Le régime de Vichy interdit l’emploi des femmes mariées dans l’administration, mesure abrogée en 1942 sous la pression de l'effort de guerre.
- 16 août 1940 : Le régime de Vichy interdit les confédérations syndicales. La CGT, la CFTC et la Confédération générale du patronat français (CGPF) seront dissoutes le 9 novembre.
- 1941 : Régime de Vichy. Louisa Mariello, 1ère femme maire d'une commune française, à Macouba en Martinique, nommée par l'amiral Robert, haut-commissaire du régime de Vichy.
- 14 mars 1941 : Régime de Vichy. Instauration du régime de retraite par répartition et du minimum vieillesse.
- juillet 1941 : Marie-Madeleine Fourcade, 1ère femme cheffe d’un grand réseau de résistance (Alliance) ; Marie Hackin, 1ère femme Compagnon de la Libération (Ordre de la Libération).
- 4 octobre 1941 : Régime de Vichy. Promulgation de la loi sur l’organisation sociale des professions, dite « charte du travail » rédigée par le syndicaliste René Belin. Elle interdit la grève ou le lock-out, et pose le principe de syndicats uniques et obligatoires.
- 1942 : France libre. Margot Duhalde, 1ère femme et seule femme aviatrice des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale.
- 15 février 1942 : Régime de Vichy. La loi considère l'avortement comme un crime contre l'État français, passible de la peine de mort.
- 23 juin 1942 : France libre. Le général de Gaulle déclare : « Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale ».
- 22 septembre 1942 : Régime de Vichy. Association de la femme à la direction de la famille.
- 6 août 1942 : Régime de Vichy. Ordonnance rétablissant la sanction pénale de l’acte homosexuel avec un mineur de 18 à 21 ans, prévoyant jusqu’à 3 ans de prison.
- 16 février 1943 : Régime de Vichy. Instauration du service du travail obligatoire (STO) pour les hommes âgés de 21 à 23 ans. Plus de 650 000 d’entre eux seront envoyés en Allemagne pour y travailler. Près de 35 000 y mourront.
- 30 juillet 1943 : Régime de Vichy. Marie-Louise Giraud est guillotinée pour avoir pratiqué des avortements.
- 13 août 1943 : Régime de Vichy. Désiré Pioge, hongreur dans la Sarthe, est condamné à mort pour avoir pratiqué des avortements. Sa demande de grâce rejetée, il est guillotiné le 22 octobre 1943.
- 20 octobre 1943 : France libre. Marthe Simard et Lucie Aubrac sont nommées membres de l'Assemblée consultative provisoire. C'est la première fois qu'une femme siège dans une assemblée parlementaire française.
- novembre 1943 : Régime de Vichy. Marie-Rose Bouchemousse, 1ère femme maire d'une commune de France métropolitaine, à Vigeois en Corrèze, nommée par le régime de Vichy.
- 1944 : Elsa Triolet, 1ère femme Prix Goncourt (pour Le premier accroc coûte deux cents francs).
- 15 mars 1944 : France libre. Le Conseil national de la Résistance (CNR) adopte son programme d’action pour la France libérée. Il préconise notamment la création de la Sécurité sociale, la sécurité de l’emploi, le droit au travail et à la retraite.
- 24 mars 1944 : France libre. Vote de l’Assemblée réunie à Alger du droit de vote pour les femmes par 51 voix sur 67.
- 21 avril 1944 : France libre. Le général de Gaulle signe l’ordonnance donnant le droit de vote et l'éligibilité aux femmes. Les militaires de carrière, hommes ou femmes, attendent 1945 pour obtenir le droit de vote (cf. : ordonnance du 21 avril 1944).
- 27 juillet 1944 : Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRP), installé à Alger, abroge la charte du travail de Vichy. Tous les syndicats, à l’exception de la CGPF, sont rétablis.
- novembre 1944 : l'Assemblée consultative provisoire, pour l'ouverture de sa session à Paris, compte dix femmes.
- 1944 : Création de la Confédération générale des cadres (CGC).
- 1945 : La notion de « salaire féminin » est supprimée. « À travail égal, salaire égal » s'inscrit dans la législation française. Plusieurs lois rappellent ce principe en 1972, 1983 et 2005, notamment.
- 1945 : Mme Blanchard-Pavie, 1ère femme admise au conseil de l'Ordre (au Mans) ; Marie-Marguerite Vigorie, 1ère femme directrice de prison, directrice de l'École nationale d'administration pénitentiaire ; Rolande Falcinelli, 1ère femme organiste (à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre).
- 2 février 1945 : ordonnance sur l'enfance délinquante instituant les tribunaux pour enfants actuels (une loi de 1912 existait auparavant), ainsi que le juge des enfants, et définissant clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif, et ce dans une perspective de réinsertion sociale.
- 22 février 1945 : Création des comités d’entreprise dans les établissements de plus de cent salariés (et de plus de cinquante l’année suivante) et du contrôle de l’emploi. Les salariés sont représentés auprès de l’employeur.
- 29 avril 1945 : premier vote féminin, lors des élections municipales.
- mai 1945 : 1ères femmes maires après Vichy : Odette Roux (Sables-d’Olonne, Vendée), Pierrette Petitot (Villetaneuse, Seine-Saint-Denis), Josèphe Jacquiot (Montgeron, Essonne), Suzanne Ploux (Saint-Ségal, Finistère), Germaine Marquer (Bruz, Ille-et-Vilaine), Geneviève Quesson (Saint-Laurent-de-la-Plaine, Maine-et-Loire) , Fortunée Boucq (Bachy, Nord), Marie Roche (Lisses, Essonne), Jeanne Berthelé (Ouessant, Finistère), Célina Roye (Saint-Omer, Pas-de-Calais) , Marie Digoy (Saint-Renan, Finistère), Berthe Grelinger (Rungis, Val-de-Marne), Charlotte Célérié (Les Clayes-sous-Bois, Yvelines), Germaine Duez (Lillers, Pas-de-Calais), Marie Giraud (Marcols-les-Eaux, Ardèche), Thérèse Maguin (Reuilly, Indre), Madeleine Ainoc (Echigey, Côte-d’Or, où le conseil municipal était d’ailleurs exclusivement composé de femmes)
- 3 octobre 1945 : Monde. Création de la Fédération syndicale mondiale (FSM), qui rassemble notamment la CGT, le CIO américain, puis tous les syndicats des pays dits socialistes.
- octobre 1944 : premier vote féminin lors d'un scrutin national : 34 femmes élues membres de l'Assemblée nationale constituante.
- 19 octobre 1945 : Mise en place de la Sécurité sociale, gérée par les partenaires sociaux et financée par les cotisations des employeurs et des salariés.
- 1945 : Loi instaurant le congé de maternité obligatoire et rémunéré de 8 semaines (2 semaines avant et 6 semaines après l’accouchement). Ce congé est rémunéré à hauteur de 50 % du salaire, 100 % pour les fonctionnaires.
- 1946 : le principe d'égalité des droits entre hommes et femmes est posé dans le préambule de la constitution.
- 1946 : 1ères femmes hôtesses de l'air pour Air France ; Yvonne-Edmond Foinant, 1ère femme à être élue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris ; Geneviève Seeuws et Marguerite Ronflard, 1ères femmes élèves de l'ENA; Charlotte Béquignon-Lagarde, 1ère femme magistrate de l'ordre judiciaire ; Odette Béquignon, 1ère femme juge de paix ; Élisabeth Boselli, 1ère femme brevetée pilote de chasse.
- 1946 : Création de l'UNESCO (United Nations Educational, Scientific et Culturel Organisation : organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture) et de l'UNICEF (United Nations Children's Fund : Fond des Nations Unies pour l'Enfance).
- 21 février 1946 : Rétablissement de la loi sur les quarante heures hebdomadaires de travail.
- 12 juin 1946 : Création du Conseil national du patronat français (CNPF).
- 30 juillet 1946 : La notion de « travail féminin » est supprimée, et l’abattement de 10 % frappant les salaires des femmes abrogé deux mois plus tard, garantissant l’égalité des hommes et des femmes comme la constitution le stipule.
- 19 octobre 1946 : Nouveau statut de la fonction publique. Le droit de grève sera reconnu en 1950.
- 27 octobre 1946 : Le préambule de la constitution de la IVe République reconnaît le droit à l’emploi et le droit de grève.
- 27 octobre 1946 : Madeleine Braun, 1ère femme vice-présidente de l'Assemblée nationale (deuxième Assemblée constituante)
- 23 décembre 1946 : Les conventions collectives instituées sous le Front populaire sont rétablies.
- 1947 : Marguerite Perey, 1ère femme correspondante de l'Académie des sciences ; Maryse Bastié, 1ère femme Commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire.
- 31 mars 1947 : Instauration du salaire minimum vital (SMV).
- 1er août 1947 : La CGT et le CNPF concluent un accord portant sur une hausse des salaires de 11 %.
- 1947 : Création de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO).
- 24 novembre 1947 : Germaine Poinso-Chapuis, 1ère femme ministre (de plein exercice) de la Santé et de la Population.
- 19 décembre 1947 : Scission au sein de la CGT avec le départ des syndicalistes de la tendance Force ouvrière (FO), qui créent la CGT-FO en avril 1948.
- 1948 : Marcelle Devaud, 1ère femme vice-présidente du Sénat.
- 1949 : Simone de Beauvoir plaide dans son livre Le Deuxième Sexe pour une autonomie de la femme. Son livre ouvre le champ d'une philosophie féministe.
- 1949 : Marguerite Boulet, 1ère femme agrégée d'histoire du droit ; Antoinette Marconnet, 1ère femme notaire (à Riom).
- 7 décembre 1949 : Monde. Création de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
- 11 février 1950 : Loi sur les conventions collectives et les conditions de travail. Instauration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), déterminé en fonction du budget type d’un ménage.
- 1951 : Jeannine Levannier, 1ère femme ceinture noire de judo.
- 18 juillet 1952 : Adoption de l’échelle mobile des salaires. Le smig est désormais indexé sur les prix.
- Fin 1952 : Christine Jorgensen a été la première à bénéficier de la chirurgie de réattribution sexuelle au Danemark, et fut outée juste après. Elle fut une active militante pour les droits des personnes transgenres.
- 1953 : Jacqueline Bauchet & Louise Cadoux, 1ères femmes membres du Conseil d'État ; Colette, 1ère femme Grand-officier de la Légion d'honneur.
- 9 août 1953 : Mise en place de la contribution patronale de 1 % de la masse salariale affectée à la construction de logements.
- 15 mars 1954 : Publication de Bonjour tristesse de Françoise Sagan qui fait scandale en raison de son « immoralité ». Sagan réplique en signalant : « Aujourd’hui, les jeunes filles écrivent ce qu’elles veulent ».
- 1955 : l'avortement thérapeutique est autorisé. Mise au point de la pilule anticonceptionnelle aux États-Unis.
- 1955 : Jacqueline Auriol, 1ère femme pilote d'essai ; Marie-Jeanne Donabedian, 1ère femme vainqueure d'une étape de La Grande Boucle féminine internationale.
- 15 septembre 1955 : Les salariés de Renault obtiennent trois semaines de congés payés et des hausses de salaires.
- 1956 : fondation de la « Maternité heureuse », qui devient le Mouvement français pour le planning familial (MFPF) quatre ans plus tard.
- 28 février 1956 : Loi sur la troisième semaine de congés payés pour tous les salariés.
- 28 mars 1956 : Création du Fonds national de solidarité (FNS) assurant une retraite minimale aux personnes âgées.
- 5 juillet 1956 : légitimation des enfants adultérins. Le mariage permet leur reconnaissance.
- 1958 : Marthe Gautier, 1ère femme biologiste qui découvre l'anomalie chromosomique responsable de la trisomie 21 ; dépossédée de sa publication.
- 19 juillet 1958 : Décret no 58-628 relatif aux travaux dangereux pour les enfants et pour les femmes.
- 31 décembre 1958 : Instauration de l’assurance-chômage (Assedic), financée par des cotisations patronales et salariées. Création de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic).
- 1959 : Jeanne Lévy, 1ère femme titulaire d'une chaire à la faculté de médecine de Paris.
- 6 janvier 1959 : Scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.
- 1959 : l’école des Ponts et Chaussées est ouverte aux filles.
- 23 janvier 1959 : Nafissa Sid Cara, 1ère femme membre d'un gouvernement de la Ve République, première musulmane secrétaire d'État.
- 20 novembre 1959 : Charte des droits de l'enfant. Texte en dix points adopté à l'unanimité par l'ONU.
- 1960 : les mères célibataires peuvent avoir un livret de famille.
- 1961 : Marcelle Clavère, 1ère femme chauffeur de bus à Paris.
- 21 janvier 1961 : Régime d’assurance-maladie pour les exploitants agricoles.
- 1962 : Marie-Louise Monnet, 1ère femme auditrice au concile de Vatican II.
- 29 décembre 1962 : Quatrième semaine de congés payés pour les salariés de Renault.
- 1963 : la mixité des élèves est instituée, par décret, comme le régime normal des Collèges d'enseignement secondaire.
- 1er mars-4 avril 1963 : Après la grève, les mineurs de Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais gagnent 11 % d’augmentation de salaire et une quatrième semaine de congés payés.
- 11 juillet 1963 : Loi introduisant un préavis de cinq jours dans les conflits du secteur public.
- 1964 : Création de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
- 1965 : Yvonne-Louise Pétrement, 1ère femme consule (en Australie) ; Olivia de Havilland, 1ère femme présidente du jury du festival de Cannes.
- 1965 : La loi du 13 juillet modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans contrat, cela permet aux femmes d’exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.
- 13 juillet 1965 : réforme des régimes matrimoniaux : les Françaises n’ont plus besoin du consentement de leur mari pour choisir une profession ou pour ouvrir un compte en banque et disposer de leurs propres biens.
- 1966 : la loi interdit de licencier une femme enceinte et pendant les 12 semaines suivant l'accouchement.
- 1966 : Deux pactes liant les pays ayant ratifié la déclaration universelle des droits de l'homme affirment la protection des enfants contre l'exploitation économique et en cas de dissolution du mariage des parents. Une mention spéciale est faite quand à la manière de traiter les jeunes détenus. Il s'agit du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
- 1966 : L'ANIFRMO, créée en 1949, devient l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
- 11 juillet 1966 : grande loi sur l’adoption, créant les deux types d’adoptions : simple et plénière.
- 18 décembre 1966 : Mise en place du Fonds national de l’emploi (FNE). Il bénéficie aux travailleurs salariés âgés de 60 ans et plus, faisant l’objet d’un licenciement collectif.
- 1967 : Marie-Madeleine Dienesch, 1ère femme présidente d'une commission parlementaire à l’Assemblée nationale (Affaires culturelles, sociales et familiales); Jacqueline Dubut & Danièle Decuré, 1ères femmes pilote de ligne (sur Air Inter); Mathilde Méliot, 1ère femme à avoir le droit d'entrer dans la Bourse de Paris ; Marcelle Campana, 1ère femme consule générale (à Toronto).
- 31 mars 1967 : Cinq organisations syndicales sont reconnues comme représentatives sur le plan national : FO, la CGT, la CFDT (Confédération française démocratique du travail, créée par une majorité de militants de la CFTC en 1964), la CFTC et la CGC (Confédération générale des cadres, fondée en 1944).
- 13 juillet 1967 : Création de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), chargée de centraliser les offres et demandes d’emplois. La France compte environ 300 000 chômeurs.
- 17 août 1967 : La participation des employés aux bénéfices de l’entreprise, facultative depuis 1959, devient obligatoire pour les établissements de plus de cinquante salariés.
- 21 août et 23 septembre 1967 : Réforme de la Sécurité sociale. Trois caisses séparées sont mises en place (maladie, vieillesse, famille), et les conseils d’administration deviennent paritaires (moitié employeurs, moitié salariés).
- 28 décembre 1967 : la loi Neuwirth autorise la vente des produits contraceptifs mais encadre la publicité. Jusqu'à 21 ans (la majorité légale), une autorisation parentale est nécessaire pour la délivrance de la pilule. La loi n'est toutefois appliquée qu'à partir de 1972 (date des derniers décrets d'application) à cause de nombreux freins de l'administration.
- 1968 : Alice Saunier-Seité, 1ère femme doyenne de faculté (de lettres et de sciences sociales de Brest) ; Christine Caron, 1ère femme porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques.
- 13 mai-18 juin 1968 : Grève générale, suivie par dix millions de travailleurs qui occupent les usines.
- 27 mai 1968 : Accords de Grenelle entre le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales : hausse du smig de 33 % et des salaires de 17 %, réduction de la durée du travail et renforcement du droit syndical dans les entreprises.
- 27 décembre 1968 : Autorisation de créer des sections syndicales dans les entreprises.
- 1969 : création de l'association nationale pour l'étude de l'avortement.
- 1969 : le Mouvement des Femmes (futur MLF) voit le jour un an après les évènements de mai 1968. Première action d’éclat le 26 août 1970 avec 8 femmes (dont Monique Wittig) déposant au pied de l’Arc de Triomphe des fleurs pour la veuve du soldat inconnu.
- 1969 : Thérèse Bertrand-Fontaine, 1ère femme membre titulaire de l'Académie nationale de médecine, première en tant que médecin ; Françoise Chandernagor, 1ère femme major de l'ENA.
- 1970 : alors que se diffuse la méthode de Karman rendant l'avortement moins dangereux, proposition de loi Peyret (député gaulliste, président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale) prévoyant un assouplissement des conditions de l'avortement thérapeutique.
- 1970 : Simone Veil, 1ère femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature.
- 1970 : Ouverture de l'École polytechnique aux femmes.
- 1970 : Le congé maternité est indemnisé à 90 % du salaire brut par la sécurité sociale (ou assurance maladie-CPAM) soit, grosso modo, le salaire net.
- 7 janvier 1970 : Instauration du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) qui remplace le smig.
- 21 mars 1970 : Évelyne Baylet, 1ère femme Présidente d'un conseil général (Tarn-et-Garonne).
- 4 juillet 1970 : suppression de la notion de chef de famille au profit de l’autorité parentale conjointe ; en cas de divorce, le père reste toutefois seul maître des décisions en tant que détenteur de la puissance paternelle. La notion de « nom patronymique » disparaît au profit de celle de « nom de famille ».
- 1971 : 1ères femmes présentes au défilé militaire du 14 Juillet de Paris.
- 1971 : Dans l'enseignement supérieur, les filles rattrapent les garçons en nombre.
- 16 mai 1971 : Instauration de la quatrième semaine de congés payés pour tous les salariés.
- 5 avril 1971 : publication dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur du « manifeste des 343 » -aussi appelé, mais pas par les initiatrices, manifeste des 343 salopes- dans lequel 343 femmes (des personnalités du spectacle, de la littérature et de la politique) déclarent avoir avorté. Aucune poursuite n'est engagée par le gouvernement Messmer.
- 16 juillet 1971 : Loi sur la formation professionnelle. Création du congé individuel de formation (CIF) et du droit à la formation professionnelle pour les salariés menacés de licenciement.
- juillet 1971 : création de l'association Choisir, par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, pour défendre les personnes accusées d'avortement.
- 20 novembre 1971 : plus de 40 000 femmes manifestent à Paris pour le droit à l'avortement.
- 31 décembre 1971 : la loi Boulin fait passer de 120 (30 ans) à 150 trimestres (37,5 ans) la période d'assurance ouvrant droit à une retraite à taux plein, sur la base des dix meilleures (et non plus dernières) années de salaire.
- 1972 : Anne Chopinet, Françoise Combelles, Anne Ferry, Nicole Gontier, Élisabeth Kerlan, Dominique Senequier et Thu-Thuy Ta, 1ères femmes élèves de l'École polytechnique ; Anne Chopinet, 1ère femme major au concours d'entrée de l'École polytechnique; Marcelle Campana, 1ère femme ambassadrice (au Panama) ; les femmes peuvent d'intégrer la gendarmerie nationale.
- 3 janvier 1972 (art. 334 du Code civil), sur la filiation : Egalité parfaite des droits et des devoirs entre les enfants naturels et les enfants légitimes. L’enfant adultérin gagne les droits à établir sa filiation, même s’il n’a droit qu’à la moitié de ce qu’il aurait eu droit en tant qu’enfant légitime ou naturel. Possibilité pour les femmes mariées de contester la paternité du mari et de reconnaître un enfant sous son nom de naissance.
- 1972 : L’école polytechnique devient mixte ; huit femmes sont reçues et l’une d’entre elles sort major de sa promotion (Anne Chopinet).
- juin 1972 : Nicole de Hauteclocque, 1ère femme Présidente du Conseil de Paris.
- octobre 1972 : procès de Bobigny, l'avocate Gisèle Halimi fait acquitter une jeune fille de 17 ans qui avait avorté, à la suite d'un viol.
- 22 décembre 1972 : Nouvelle loi pour l’égalité des salaires entre hommes et femmes.
- 1973 : La conférence internationale du travail adopte la convention qui fixe l'âge du travail à 15 ans révolus. Elle entre en vigueur en France en 1976.
- 1973 : La mère peut, comme le père, transmettre sa nationalité à son enfant (légitime ou naturel). L'éducation sexuelle fait son apparition dans les programmes scolaires.
- 1973 : Florence Cayla, 1ère femme major d'HEC; Jacqueline de Romilly, 1ère femme professeure au Collège de France; Alice Saunier-Seité, 1ère femme rectrice d'université (de l'Académie de Reims) ; Marcelle Pipien, 1ère femme présidente d'un tribunal administratif ; Agathe Mella, 1ère femme directrice de France Culture.
- 5 février 1973 : publication à l'initiative du Groupe d'information santé du manifeste de 331 médecins qui revendiquent dans le Nouvel Observateur avoir pratiqué des avortements.
- avril 1973 : fondation du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC).
- 12 juin 1973 : A Besançon, les salariés de l’entreprise horlogère Lip, en liquidation judiciaire, occupent l’usine, reprennent la production et la commercialisent. Le conflit durera jusqu’en 1977.
- 13 juillet 1973 : Modification du code du travail concernant la résiliation du contrat à durée indéterminée (CDI) : l’employeur doit respecter des procédures de licenciement.
- 1973 : Création de la Confédération européenne des syndicats (CES). Loi Royer (27 décembre) sur la grande distribution qui, pour préserver le commerce et l'artisanat, oblige à requérir une autorisation pour ouvrir des grandes surfaces commerciales.
- mai 1974 : Arlette Laguiller, 1ère femme candidate à une élection présidentielle.
- 28 juin 1974 : l'Assemblée nationale vote le projet de Simone Veil ministre de la Santé, qui libéralise totalement la contraception. La Sécurité sociale rembourse la pilule. Les mineures ont droit à l'anonymat.
- 5 juillet 1974 : La majorité est abaissée à l'âge de 18 ans.
- 14 octobre 1974 : Accord entre le CNPF et les syndicats. Les salariés licenciés pour raison économique toucheront 90 % de leur rémunération brute pendant un an. ll instaure également l’autorisation administrative de licenciement, qui sera supprimée en juillet 1986.
- 26-29 novembre 1974 : débat houleux à l'Assemblée nationale sur le projet de Simone Veil, d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse (IVG) par 277 voix contre 192.
- 1975 : Marie-Thérèse Goutmann, 1ère femme présidente d'un groupe parlementaire au Sénat ; Jacqueline Baudrier, 1ère femme Présidente-Directrice générale d'une entreprise publique des médias (Radio France) ; Denise Rémuzon, 1ère femme membre du conseil supérieur de la magistrature ; Suzanne Challe, 1ère femme présidente de chambre à la Cour d'appel ; Jacqueline de Romilly, 1ère femme élue à l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; Jacqueline Baudrier, 1ère femme présidente-directrice-générale de Radio France.
- 3 janvier 1975 : La loi sur les licenciements pour cause économique impose à l’employeur la consultation préalable des représentants du personnel.
- 17 janvier 1975 : promulgation de la loi Veil, mise en place pour une période de cinq ans.
- 30 juin 1975 : Loi d’orientation en faveur des travailleurs handicapés.
- 1975 : Loi Haby et ses décrets d’application organisent l’obligation de mixité dans tous les établissements publics.
- 11 juillet 1975 : consécration d’un véritable « droit au divorce » : ajout au divorce pour faute de 2 motifs de divorce : par consentement mutuel et « rupture de la vie commune ». Dépénalisation de l’adultère. La loi soumet à un accord commun entre les époux le choix du domicile conjugal. La loi supprime également la possibilité laissée au mari de contrôler les correspondances de son épouse.
- 1975 : Ouverture du « refuge Flora Tristan » pour femmes battues à Clichy.
- 1975 : La loi sanctionne désormais les discriminations fondées sur le sexe, en particulier en matière d'embauche, et garantit l'accès à l'emploi des femmes enceintes.
- 1976 : Hélène Vida, 1ère femme présentatrice d'un journal télévisé du soir (sur Antenne 2) ; Martine Luc-Thaler, 1ère femme avocate aux conseils ; Marion Tournon-Branly, 1ère femme admise à l'Académie d'architecture ; Valérie André, 1ère femme médecin général (général de brigade).
- 12 janvier 1976 : Alice Saunier-Seïté, 1ère femme ministre des Universités.
- 7 mai 1976 : Florence Hugodot, 1ère femme sous-préfète d'un arrondissement.
- 22 décembre 1976 : suppression de l’interdiction d’adopter un enfant en présence de descendants.
- 1977 : Création du « congé parental d'éducation » pour les femmes dans les entreprises de plus de 200 salariés.
- 1977 : Accord interprofessionnel sur la mensualisation.
- 1977 : Dominique Roux, 1ère femme élève-officier de la marine nationale.
- 1977 : fermeture définitive de la colonie pénitentiaire pour enfants à Belle-Ile.
- 1978 : Danièle Carré-Cartal, 1ère femme meilleure sommelier de France ; Dominique Segond-Griffoulière, 1ère femme agrégée de mécanique.
- 1979 : Année internationale de l'enfance. Mise en chantier de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant à l'initiative de la mission permanente de la république populaire de Pologne. Cette mission est présidée par le polonais Adam Lopatka.
- 1979 : l'interdiction du travail de nuit est supprimée pour les femmes occupant des postes de responsabilité.
- 1979 : Yvonne Choquet-Bruhat, 1ère femme élue à l'Académie des sciences.
- 18 janvier 1979 : Réforme des conseils de prud’hommes. L’institution est élargie à l’ensemble du territoire et à toutes les activités salariales.
- 17 juillet 1979 : Simone Veil, 1ère femme Présidente du Parlement européen.
- 30 novembre 1979 : la loi Veil est reconduite définitivement.
- 1980 : Marguerite Yourcenar, 1ère femme élue à l'Académie française ; Micheline Collin, 1ère femme capitaine de brigade de sapeurs-pompiers.
- 1980 : Le congé maternité est porté à 16 semaines minimum (6 semaines avant et 10 semaines après l’accouchement) avec versement complet du salaire. À partir du troisième enfant, le congé maternité minimum est de 24 semaines.
- 1980 : Maud Marin, 1ère femme avocate transgenre.
- 1981 : Nicole Pradain, 1ère femme procureur générale ; Michèle Mouton, 1ère femme gagnante d'une étape du Championnat du monde des rallyes (rallye Sanremo) ; Valérie André, 1ère femme médecin général inspecteur (général de division).
- 22 mai 1981 : Édith Cresson, 1ère femme ministre de l'Agriculture, Nicole Questiaux, 1ère femme ministre de la Solidarité nationale.
- 12 juin 1981 : Homosexualité déclassifiée comme une maladie.
- juillet 1981 : Yvette Chassagne, 1ère femme préfète (de Loir-et-Cher).
- août 1981 : Michèle Cotta, 1ère femme Présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
- 1982 : Yvonne Brucker, 1ère femme conductrice du métro de Paris.
- 1982 : Les femmes d'artisans ou de commerçants peuvent choisir entre trois statuts : conjoint collaborateur, salarié ou associé.
- 1982 : Un projet de loi prévoit d'instaurer un quota de 25 % de femmes pour les listes de candidatures. Elle est rejetée par le Conseil constitutionnel.
- 13 janvier 1982 : Instauration de la semaine de trente-neuf heures et de la cinquième semaine de congés payés, en vertu d’un accord interprofessionnel signé l’année précédente.
- 27 janvier 1982 : Limitation du recours au travail temporaire et au contrat à durée déterminée (CDD).
- 8 mars 1982 : Première journée nationale des femmes.
- 25 mars 1982 : L’âge de la retraite est abaissé à 60 ans (57 ans pour les fonctionnaires) pour les salariés disposant des 37,5 annuités nécessaires au taux plein de 50 % du salaire annuel moyen.
- Août-décembre 1982 : Lois Auroux : droit d’expression directe, renforcement du pouvoir des comités d’entreprise, développement des instances représentatives, négociation annuelle des salaires, mise en place des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
- 1982 : Création de l'impôt sur les grandes fortunes, transformé en 1989 en impôt de solidarité sur la fortune.
- 4 août 1982 : suppression de toute pénalisation de l’homosexualité impliquant des personnes de plus de 15 ans, âge de la majorité sexuelle.
- 31 décembre 1982 : la loi Roudy permet le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale.
- 1983 : Martine Rolland, 1ère femme guide de haute-montagne ; Myriam Ezratty, 1ère femme directrice de l'Administration pénitentiaire ; Nadine Picquet, 1ère femme directrice d'une prison pour hommes (maison d'arrêt de Bois-d'Arcy) ; Dominique Roux, 1ère femme embarquée sur un bâtiment naval militaire.
- 9 janvier 1983 : Loi portant création du forfait hospitalier, qui s’élève à 20 francs (un peu plus de 3 euros). Actuellement, il atteint 16 euros.
- 13 juillet 1983 : Loi Roudy établit l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
- 1984 : Simone Rozès, 1ère femme premier président de la Cour de cassation ; Darie Boutboul, 1ère femme jockey vainqueur d'une course de tiercé.
- 1984 : Le congé parental est ouvert à chacun des parents salariés sans distinction de sexe. La loi confie aux deux parents la gestion conjointe des biens de leurs enfants mineurs. Désormais, les parents ont la possibilité d'ajouter au nom patronymique de l'enfant le nom de son autre parent (en général celui de la mère).
- 17 juillet 1984 : Huguette Bouchardeau, 1ère femme ministre de l'Environnement.
- 26 septembre 1984 : Création des travaux d’utilité collective (TUC), destinés à fournir aux jeunes chômeurs un « petit boulot » dans les services publics. Ils seront remplacés en 1990 par les contrats emploi-solidarité (CES).
- 1985 : Les femmes sont autorisées à intégrer le corps des agents de change.
- 1985 : Sylvie Girardet, 1ère femme agent de change ; Catherine Bréchignac, 1ère femme directrice de recherche au CNRS ; Madeleine Griselin, 1ère femme cheffe d'expédition au pôle Nord ; Isabelle Boussaert, 1ère femme pilote en service dans l'armée de l'air ; Micheline Chanteloube, 1ère femme directrice d'une grande école militaire (École du Service de santé militaire de Lyon).
- 23 décembre 1985 : nouvelle réforme des régimes matrimoniaux : les époux deviennent véritablement égaux aux yeux de la loi.
- 1986 : Jeanine Meilhon, 1ère femme trésorière-payeuse générale.
- 28 février 1986 : Loi sur l’aménagement du temps de travail : il est désormais possible de négocier collectivement un horaire annuel dérogeant à l’ensemble des règles de l’horaire hebdomadaire.
- 3 juillet 1986 : Suppression de l’autorisation administrative de licenciement pour raisons économiques.
- 30 décembre 1986 : Un plan social devient obligatoire quand dix salariés sont licenciés dans une entreprise employant au moins cinquante personnes.
- 1987 : Loi Séguin sur l’aménagement du temps de travail.
- 22 juillet 1987 : création du principe de coparentalité, qui existe même en cas de divorce.
- 1988 : Christine Spiesser-Morelle, 1ère femme bouchère-charcutière, titulaire d'un brevet de maîtrise de boucher-charcutier ; Sophie Deicha, 1ère femme professeure de théologie orthodoxe ; Myriam Ezratty, 1ère femme première présidente de la Cour d'appel de Paris ; Isabelle Guion de Méritens, 1ère femme officière de la Gendarmerie nationale ; Louise Coppolani, 1ère femme commissaire général de brigade ; Andrée Tourne, 1ère femme général de brigade de l'armée de terre.
- 1er décembre 1988 : Création du Revenu minimum d'insertion (RMI).
- 1989 : Josiane Serre, 1ère femme directrice de l'École normale supérieure ; Marie-Madeleine Fourcade, 1ère femme à avoir dorit aux obsèques et hommage solennel en l'église Saint-Louis-des-Invalides.
- 1989 : Loi sur la prévention du licenciement économique et le droit à la conversion.
- 20 novembre 1989 : Adoption à l'ONU de la Convention Internationale des droits de l'enfant. Elle comporte 54 articles. Son préambule insiste sur la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant.
- 8 décembre 1989 : Union européenne. Le Conseil européen de Strasbourg adopte la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Elle concerne l’équité salariale, la liberté syndicale, la négociation collective, l’égalité de traitement entre hommes et femmes, etc.
- 1990 : Pauline Bebe, 1ère femme rabbin ; Florence Arthaud, 1ère femme victoire à la Route du rhum.
- 1990 : Le mouvement américain pro-life, c'est-à-dire anti avortement, essaime en France. Première attaque d’un commando anti-IVG à la maternité des Lilas (Seine-Saint-Denis).
- 1990 : La loi reconnaît qu’il peut y avoir viol entre époux.
- 5-9 mars 1990 : Déclaration Mondiale sur l'Éducation pour tous à Jomtiem (Thaïlande) par 155 pays représentés.
- 17 mai 1990 : l’OMS retire l’homosexualité de la liste des maladies mentales.
- 29-30 septembre 1990 : Premier sommet mondial pour l'enfance au siège de l'ONU (en présence de 71 chefs d' États et de Gouvernements et de 88 représentants d'autres pays). Il y est adoptée une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant.
- 1991 : Madeleine Rebérioux, 1ère femme présidente de la Ligue des droits de l'homme ; Joëlle Timsit, 1ère femme directrice des Affaires Politiques du ministère des Affaires étrangères ; Louise Coppolani, 1ère femme commissaire général de division ; Isabelle Autissier, 1ère navigatrice au monde à faire le tour du monde en compétition.
- 15 mai 1991 : Édith Cresson, 1ère femme Première ministre.
- 16 mai 1991 : Martine Aubry, 1ère femme ministre du Travail.
- 21 juin 1991 : Le harcèlement sexuel au travail devient un délit, passible d’une peine de prison.
- 31 décembre 1991 : La loi impose à chaque entreprise de définir une politique de prévention adéquate des risques professionnels.
- 11 mars 1992 : Noëlle Lenoir, 1ère femme membre du Conseil constitutionnel.
- 27 mars 1992 : Lucette Michaux-Chevry, 1ère femme présidente du conseil régional de la Guadeloupe.
- 27-31 mars 1992 : Fermeture du site historique de la « forteresse ouvrière » des chaînes Renault, sur l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt.
- 31 mars 1992 : Marie-Christine Blandin, 1ère femme présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.
- 26 mai 1992 : Première réforme du statut des dockers : indépendants jusqu’alors, ils deviennent des salariés des entreprises de manutention.
- 22 juillet 1992 : la loi réprime les violences conjugales. Aggravation des peines pour les époux ou concubins coupables de violences familiales.
- 20 octobre 1992 : Nicole Notat, 1ère femme dirigeante d'une confédération syndicale (secrétaire générale de la CFDT).
- 2 novembre 1992 : Loi définissant l’abus d’autorité en matière de harcèlement sexuel dans les relations de travail.
- 23 décembre 1992 : Texte annulant les procédures de licenciement non accompagnées de plan de reclassement.
- 1993 : Dominique Magne, 1ère femme commandant d'un bâtiment de la Marine nationale.
- 27 janvier 1993 : la loi Neiertz crée le délit d'entrave à l'IVG en réaction aux commandos anti-IVG.
- 8 janvier 1993, relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant : fin de la distinction enfants naturels/légitimes, concernant le nom. L'autorité parentale devient conjointe, quelle que soit la situation des parents (mariés, divorcés ou concubins) : « l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents non mariés à condition « qu’ils vivent en commun au moment de la reconnaissance concomittante ou de la seconde reconnaissance. ».
- Mars 1993 : Le nombre de chômeurs dépasse la barre des 3 millions.
- 19 novembre 1993 : Vote de la loi quinquennale sur le travail, l’emploi et la formation professionnelle. Elle assouplit notamment la réglementation en faveur des entreprises.
- 23 novembre 1993 : Union européenne. Une directive sur le temps de travail fixe un plafond hebdomadaire à quarante-huit heures. Mais une clause dérogatoire (opt-out), d’inspiration anglo-saxonne, permet à une entreprise de dépasser ce plafond avec l’accord du salarié.
- 1993 : la réforme Balladur des retraites, est l'une des plus importantes de l'histoire de la retraite en France et des Systèmes de retraite en Europe et a principalement consisté à allonger la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou sans décote et le nombre des « meilleures années » prises pour calculer le montant de la pension.
- 1994 : Martine Monteil, 1ère femme cheffe de la brigade de répression du banditisme de Paris.
- 1er mars 1994 : entrée en vigueur du nouveau code pénal dépénalisant l'avortement (lois promulguées le 22 juillet 1992).
- 10 mars 1994 : Les étudiants manifestent contre le projet de contrat d’insertion professionnelle (CIP), dit « smic-jeunes ». Il sera abandonné le 30 mars.
- 29 juillet 1994 : lois bioéthiques. Droit à la filiation, grâce à la PMA. Le consentement à la PMA interdit toute action en contestation de filiation.
- 1995 : Le Parlement Français décide de faire du 20 novembre la "Journée nationale de défense et de promotion des droits de l'Enfant".
- 20 avril 1995 : Marie Curie, 1ère femme entrée au Panthéon (pour sa propre œuvre).
- 4 août 1995 : Création du contrat initiative-emploi (CIE), destiné principalement aux chômeurs de longue durée et aux bénéficiaires des minima sociaux.
- Novembre-décembre 1995 : Le plan Juppé sur la Sécurité sociale et les régimes spéciaux de retraite provoque un vaste mouvement de grèves. Ces derniers seront maintenus, mais l’allongement du temps de cotisation pour les salariés du privé est décidé.
- 1996 : Nelly Viennot, 1ère femme arbitre de touche de football professionnel masculin ; Martine Monteil, 1ère femme cheffe de la brigade criminelle.
- 11 juin 1996 : Loi de Robien favorise l’aménagement et la réduction du temps de travail par des incitations financières (allégement des cotisations patronales).
- 5 juillet 1996 : Loi Raffarin qui renforce les dispositions de la Loi Royer de 1973 sur la grande distribution.
- 17 août 1996 : Claudie Haigneré, 1ère femme astronaute.

- 9 décembre 1996 : Isabelle Renouard, 1ère femme secrétaire générale de la Défense nationale.
- 1997 : Catherine Bréchignac, 1ère femme directrice du CNRS; Claudine Montgelard, 1ère femme biologiste, phylogénéticienne qui définit le clade des cétartiodactyles.
- 4 juin 1997 : Élisabeth Guigou, 1ère femme ministre de la Justice ; Catherine Trautmann, 1ère femme ministre de la Culture.
- 16 octobre 1997 : Mise en place des emplois-jeunes, rémunérés au smic horaire.
- Décembre 1997 : Des comités de chômeurs occupent des antennes Assedic et des ANPE en province et à Paris. Ils réclament notamment une réévaluation des minima sociaux. Le mouvement se poursuivra jusqu’en juin 1998.
- 1998 : Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 1ère femme Grand-croix de la Légion d'honneur.
- 8 mars 1998 : Publication au Journal officiel (JO n°57 du 8) d’une circulaire relative à la féminisation des noms de métier, de fonction, grade ou titre.
- 13 juin 1998 : La loi Aubry prévoit l’instauration de la semaine de trente-cinq heures à partir du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de vingt salariés et à partir du 1er janvier 2002 dans les autres entreprises. L’annualisation du temps de travail est étendue.
- 27 octobre 1998 : Le CNPF prend le nom de Mouvement des entreprises de France (Medef).
- 1999 : Hélène Carrère d'Encausse, 1ère femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française ; Caroline Aigle, 1ère femme pilote de chasse (première femme à être affectée au sein d’un escadron de combat de l'Armée de l'air française).
- 1999 : Couverture maladie universelle.
- 8 juillet 1999 : Promulgation de la loi constitutionnelle n° 99-569 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (JO n°157 du 9).
- 2 septembre 1999 : Catherine Génisson, députée (PS) du Pas-de-Calais, remet à Lionel Jospin, Premier ministre, un rapport dressant un tableau des inégalités hommes-femmes au travail : 7% de femmes parmi les cadres dirigeants des 5 000 premières entreprises françaises et 27% de différence moyenne de salaire aux dépens des femmes. Le rapport présente 30 mesures susceptibles de corriger ces inégalités.
- 15 novembre 1999 : création du Pacte civil de solidarité (pacs), conçu comme « un partenariat contractuel établi entre deux personnes majeures, indépendamment de leur sexe, et qui a pour objet d'organiser leur vie commune en établissant entre eux des droits et des devoirs en terme de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d' impôts et de droits sociaux ». Inscription de la notion de concubinage dans le Code civil, juste après le Pacs.
- 15 novembre 1999 : Reconnaissance des couples de même sexe comme partenariat enregistré.
- 4 décembre 1999 : Michèle Alliot-Marie, 1ère femme élue présidente d'un grand parti (RPR).
XXIe siècle
- 2000 : la Journée nationale de défense des droits de l'enfant devient journée européenne puis journée internationale.
- 2000 : Claire Pothier, 1ère femme major de promotion, à la sortie de l'École navale (phase école d'application des officiers de marine) ; Marie-Françoise Bechtel, 1ère femme directrice de l'ENA ; Tonie Marshall, 1ère femme César du meilleur réalisateur (pour Vénus beauté (institut)).
- 19 janvier 2000 : La loi Aubry II allège les cotisations sociales sur les bas et moyens salaires pour les entreprises passées aux trente-cinq heures. Le calcul du temps de travail est revu (excluant certaines pauses, par exemple).
- 25 février 2000 : convention interministérielle est signée entre les ministères de l’emploi et de la solidarité, de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la pêche, de la recherche et de la technologie et avec le secrétariat d’état aux droits des femmes et à la formation professionnelle afin qu’une politique d’égalité des chances entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes dans le système éducatif soit mise en place.
- 6 juin 2000 : Promulgation de la loi n° 2000-493 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (JO n° 131 du 7).
- 14 juin 2000 : Signature par le patronat, la CFDT et la CFTC d’une nouvelle convention d’assurance-chômage prévoyant la mise en place du PARE (plan d’aide au retour à l’emploi). Bien que dénoncé par FO, la CGT et la CGC, il entre en vigueur le 1er janvier 2001.
- 2001 : la stérilisation, depuis longtemps interdite en France, est autorisée par modification du Code pénal, la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001-art.26 JORF 7 juillet 2001.
- 2001 : Béatrice Vialle, 1ère femme pilote du Concorde ; Anne Lauvergeon, 1ère femme dirigeante d'une grande entreprise (Alcatel-Lucent).
- mars 2001 : dans les collèges et les lycées, les infirmières scolaires sont autorisées à délivrer la pilule du lendemain (Norlevo).
- 9 mai 2001 : Adoption de la loi Génisson sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette loi actualise et renforce la loi de 1983 en définissant les axes de sa mise en œuvre.
- 9 mai 2001 : Levée de l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie.
- 4 juillet 2001 : la loi Aubry porte de 10 à 12 semaines le délai légal de l'IVG et supprime l'autorisation parentale pour les mineures.
- 6 novembre 2001 : loi relative à la lutte contre les discriminations à l’emploi.
- 3 décembre 2001 : suppression du concept d’enfant adultérin, au profit de celui d’enfant naturel. Unification des règles applicables aux enfants, sans accorder aucune incidence au statut juridique de leurs parents, mariés, pacsés, divorcés, concubins ou divorcés ; loi du 27/06 : Le tribunal de Grande Instance de Paris accepte pour la 1e fois l’adoption par une femme homosexuelle des 3 enfants de sa compagne.
- 2002 : Rose-Marie Van Lerberghe, 1ère femme directrice générale du plus grand établissement public de santé (Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Anne-Marie Idrac, présidente d'un EPIC de transport en commun (Régie autonome des transports parisiens [RATP]), ainsi que Société nationale des chemins de fer français [SNCF] en 2006) ; Anita Guerreau-Jalabert, 1ère femme directrice de l'École nationale des chartes ; Chantal Desbordes, 1ère femme contre-amiral de la Marine nationale ; Martine Monteil, 1ère femme directrice centrale de la police judiciaire.
- 1er janvier 2002 : apparition du congé de paternité.
- 9 janvier 2002 : décret no 2002-39, qui oblige les pharmaciens à distribuer gratuitement la pilule du lendemain aux mineures.
- 17 janvier 2002 : Loi de modernisation sociale : restriction du recours au licenciement économique, obligation de passer un accord sur les 35 heures avant de procéder à des licenciements collectifs, encadrement de la précarité, lutte contre le harcèlement moral au travail...
- 4 mars 2002 (art. 311-21, loi n°2002-305), sur l’autorité parentale : elle pose le principe de l'exercice commun de l'autorité parentale. Les titulaires de l'autorité parentale sont les parents, en principe deux. Les parents peuvent choisir d’un commun accord le nom de famille de leur enfant (à défaut choix du père).
- 7 mai 2002 : Michèle Alliot-Marie, 1ère femme ministre de la Défense ; Brigitte Girardin, 1ère femme ministre de l'Outremer.
- 9 septembre 2002 : loi Perben I créant les établissements pénitentiaires pour mineurs de 13 à 18 ans (les premiers établissements ont été ouverts en 2007-2008 à Lyon, Valenciennes,Toulouse, Mantes-la-Jolie, Nantes et Marseille).
- 4 janvier 2003 : La loi Fillon étend le contingent légal d’heures supplémentaires et suspend la plupart des dispositions de la loi du 17 janvier 2002.
- 2003 : Le 12 juin est déclaré "Journée mondiale contre le travail des enfants" par l'ONU.
- 11 avril 2003 : Promulgation de la loi n° 2003-327 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen. Elle instaure la règle de l’alternance des candidats de chaque sexe sur les listes présentées aux électeurs.
- 24 juillet 2003 : La retraite des fonctionnaires, « alignée » sur le secteur privé, est portée à 40 annuités malgré une forte mobilisation sociale.
- 21 août 2003 : Loi Fillon sur la réforme des retraites, complétant la réforme Balladur.
- décembre 2003 : après une vive polémique, le gouvernement Raffarin repousse la proposition du député UMP Jean-Paul Garraud, instituant un délit d'interruption involontaire de grossesse. Cet amendement visait à créer un délit d'homicide involontaire pour un médecin ayant entraîné la mort d'un enfant à naître sans le consentement de la mère, en prévoyant une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en cas d’interruption de grossesse causée « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence »17.
- 4 mai 2004 : Création d’un droit individuel à la formation (DIF) pour chaque salarié.
- 5 juin 2004 : célébration du 1er mariage homosexuel, par le maire de Bègles Noël Mamère, qui sera définitivement annulé en mars 2007, la loi française ne permettant pas le mariage homosexuel.
- juillet 2004 : l'IVG médicamenteuse est autorisée chez les gynécologues et certains médecins généralistes pour les grossesses inférieures à cinq semaines.
- 2005 : Maud Fontenoy, 1ère femme navigatrice à la rame et en solitaire de l'océan Pacifique.
- 19 janvier 2005 : Loi de cohésion sociale préparée par le Ministre du Travail et des Affaires sociales Jean-Louis Borloo (gouvernement Raffarin et Villepin). L’ANPE perd son monopole de placement des chômeurs au profit des entreprises privées.
- 31 mars 2005 : Les modalités d’application des trente-cinq heures sont assouplies.
- 5 juillet 2005 : Laurence Parisot, 1ère femme présidente du MEDEF.
- 2 août 2005 : Mise en place du contrat nouvelles embauches (CNE), qui prévoit une période d’essai de deux ans. Contraire aux conventions de l’OIT, il sera abrogé en juin 2008.
- 2006 : Muriel Mayette, 1ère femme directrice d'un théâtre national (administratrice générale de la Comédie-Française).
- 24 février 2006 : la Cour de Cassation accepte qu’un parent homosexuel délègue l’autorité parentale à son partenaire homosexuel.
- 23 mars 2006 : Promulgation de la loi n° 2006-340 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
- Mars-avril 2006 : Importante mobilisation étudiante contre le contrat première embauche (CPE). Le texte est retiré.
- 4 avril 2006 : Loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, elle prévoit des sanctions pénales aggravées lorsque l’auteur est l’ancien ou l’actuel conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un Pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. Introduction de la notion de respect dans les obligations du mariage. Alignement de l’âge légal du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans.
- 1er novembre 2006 : Monde. Création de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui réunit la plupart des syndicats dans le monde.
- 2007 : Anne-Sophie Pic, 1ère femme cheffe de l'année selon le guide Michelin.
- 2007 : Loi TEPA (ou « paquet fiscal »), qui contient entre autres une mesure de défiscalisation des heures supplémentaires (gouvernement Fillon).
- 14 mars 2007 : Mise en place du 3919, numéro de téléphone national unique destiné aux victimes et aux témoins de violences conjugales.
- 6 mai 2007 : Ségolène Royal, 1ère femme présente au second tour d'une élection présidentielle.
- 18 mai 2007 : Michèle Alliot-Marie, 1ère femme ministre de l'Intérieur.
- 19 juin 2007 : Christine Lagarde, 1ère femme ministre de l'Economie et des Finances.
- 31 juillet 2007 : Promulgation de la loi n° 2007-128 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
- 21 août 2007 : Loi sur le service minimum dans les transports et l’obligation pour un salarié d’indiquer 48 heures avant son intention de faire grève.
- 22 janvier 2008 : la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour le refus d’adoption par une femme homosexuelle.
- 13 février 2008 : Loi instaurant la fusion de l’Unedic et de l’ANPE. Leur regroupement donnera naissance au Pôle emploi le 16 octobre 2008.
- 26 février 2008 : Promulgation de la loi n° 2008-175 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général (JO n° 49 du 27).
- 1er mai 2008 : Entrée en vigueur du nouveau code du travail, qui cloisonne les statuts et étend la possibilité pour le gouvernement de décider par décret.
- 10 juin 2008 : Révision de la directive européenne sur le temps de travail. Le système de l’opt-out est généralisé, et il est possible de travailler jusqu’à soixante-cinq heures par semaine, voire plus si une convention collective le permet.
- 25 juin 2008 : Loi dite de « modernisation du marché du travail » : elle augmente d’un mois la période d’essai, crée la « rupture conventionnelle » d’un CDI sur simple « accord » mutuel, et instaure le CDD longue durée (entre 18 mois et 36 mois), supprime la limite de 300 m² prévue dans le cadre de la loi Raffarin de 1996 au-delà desquels les grandes surfaces commerciales doivent requérir une autorisation pour ouvrir..
- 23 juillet 2008 : Les trente-cinq heures restent la durée légale, mais la semaine peut atteindre quarante-huit heures, dans la limite de 405 heures supplémentaires par an.
- 20 août 2008 : Réforme de la représentativité syndicale fixée à 10 % des voix dans l’entreprise. Un accord doit être signé par des syndicats totalisant au moins 30 % des suffrages, et ne pas être rejeté par des organisations ayant recueilli au moins 50 % des votes.
- 1er décembre 2008 : Adoption de la loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) pour compenser d’éventuelles pertes de revenus en cas de reprise d’emploi. Il remplace alors le RMI et l’allocation de parent isolé.
- 16 janvier 2009 : loi sur la réforme de la filiation : abandon des notions de filiation légitime et de filiation naturelle : le principe est désormais celui de l’égalité entre tous les enfants, qu’ils soient nés de couples mariés ou non. Une disposition permet aux enfants nés sous X (la mère accouchant sans déclarer son identité et confiant l’enfant à l’adoption) de procéder à une recherche en maternité. Les mères conserveront cependant le droit de maintenir le secret de leur accouchement.
- 21 juillet 2009 : La loi HPST dite aussi loi Bachelot permet la délivrance par les pharmaciens de produits contraceptifs avec une ordonnance légèrement dépassée de date.
- 2010 : La lutte contre les violences faites aux femmes est déclarée grande cause nationale.
- 2010 : Michèle Alliot-Marie, 1ère femme ministre des Affaires étrangères ; Dominique de La Garanderie, 1ère femme bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris.
- 9 juillet 2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : création de l’ordonnance de protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple. La loi renforce le dispositif de prévention et de répression des violences faites aux femmes en instituant notamment l’ordonnance de protection des victimes et en mettant en place une surveillance électronique du conjoint violent (bracelet électronique).
- 9 novembre 2010 : Promulgation de la loi portant réforme des retraites. Un nouvel article inséré dans le code du travail fait obligation aux entreprises de plus de 50 salariés de signer, à partir du 1er janvier 2012, un accord ou à défaut un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une sanction financière pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale de l’entreprise.
- 2011 : Sylvie Bermann, 1ère femme ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France dans un pays membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations unies (en Chine continentale).
- 29 juin 2011 : Valérie Pécresse, 1ère femme ministre du Budget.
- 5 juillet 2011 : Christine Lagarde, 1ère femme Directrice générale du Fonds monétaire international.
- 2011 : Nicole Bricq, 1ère femme rapporteure générale du budget au Sénat.
- 6 août 2012 : Vote de la Loi n° 2012-954 relative au harcèlement sexuel. Le texte donne une nouvelle définition du harcèlement sexuel, établit des circonstances aggravantes et détermine les sanctions qui y sont associées. La loi a été votée en procédure d’urgence à la suite du vide juridique provoqué par une décision du Conseil constitutionnel qui avait annulé l’article du code pénal sur le harcèlement sexuel. Le Conseil avait jugé que l’article était contraire au principe constitutionnel de l’égalité des délits et des peines, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
- 30 novembre 2012 : Réunion du Comité interministériel aux droits des femmes, non réuni depuis 12 ans. Il définit les actions d’un plan 2013-2017 mettant les droits des femmes au cœur des politiques publiques.
- 17 décembre 2012 : le financement de la sécurité sociale prévoit une prise en charge à 100 % des IVG par l'assurance maladie.
- 2013 : Isabelle Guion de Méritens, 1ère femme général de brigade de la Gendarmerie.
- janvier 2013 : Barbara Pompili, 1ère femme présidente d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
- 17-29 mai 2013 : Le 17, promulgation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le 28, publication au Journal officiel du décret d’application de la loi et modifiant diverses disposition relatives à l’état civil et au code de procédure civile. Le 29, célébration à Montpellier du premier mariage homosexuel.
- 17 mai 2013 : Adoption ouverte aux couples de même sexe.
- Novembre 2013 : Quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016). Il prévoit un doublement des moyens dédiés (66 millions d’euros sur trois ans).
- 1er novembre 2013 : l’Allemagne est devenue le premier pays européen à offrir une alternative à la dichotomie sexuelle imposée par l’état civil à la naissance. Il est en effet désormais possible de ne pas préciser le sexe « masculin » ou « féminin » dans l’acte de naissance pour les nouveau-nés présentant un sexe génital et gonadique ambivalent.
- Décembre 2013 : Vote par l’Assemblée nationale de la proposition de loi portant sur la lutte contre le système prostitutionnel. Le texte supprime le délit de racolage mais rejette la pénalisation du client de la prostitution.
- 2014 : Corinne Diacre, 1ère femme entraîneur d'une équipe de football professionnel masculine ; Stéphanie Frappart, 1ère femme arbitre principale de football professionnel masculin ; Monique Legrand-Larroche, 1ère femme ingénieure générale hors classe (général de corps d'armée).
- 4 juillet 2014 : Ratification par la France de la convention du Conseil de l’Europe, dite Convention d’Istanbul, sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique. La France est le 13e État à ratifier cette convention.
- 5 avril 2014 : Anne Hidalgo, 1ère femme maire de Paris.
- 23 avril 2014 : Valérie Rabault, 1ère femme rapporteure générale du budget à l'Assemblée nationale.
- 4 aout 2014 : Promulgation de la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (JO du 5). Le texte vise à combattre les inégalités hommes-femmes dans la sphère professionnelle, publique et privée. Elle prévoit notamment la sanction du non-respect des dispositions sur l’égalité professionnelle par l’interdiction d’accès à la commande publique (marchés publics, contrats de partenariat et délégations de service public). En outre, la loi supprime la notion de "détresse" dans le cadre d’une demande d’IVG. Elle est remplacée par l’expression "qui ne veut pas poursuivre une grossesse".
- 26 août 2014 : Najat Vallaud-Belkacem, 1ère femme ministre de l'Education nationale.
- En 2015 les juges pour enfants ont été saisis pour 103 885 mineurs en danger.
- Mars 2015 : Publication d’une étude sur les violences faites aux femmes dans les transports collectifs par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes qui recommande une plan national d’action "Stop au harcèlement sexiste et aux violences sur toute la ligne".
- 2016 : Sophie Bellon, 1ère femme PDG d'une entreprise du CAC 40 (Sodexo) ; Nathalie Boy de la Tour, 1ère femme présidente de la Ligue de football professionnel.
- 26 janvier 2016 : La loi de modernisation de notre système de santé supprime le délai minimal de réflexion d’une semaine pour l’IVG. Elle permet aux sages-femmes de pratiquer des IVG médicamenteuses et aux centres de santé de pratiquer des IVG instrumentales.
- 7 mars 2016 : Loi relative au droit des étrangers en France : la loi donne plus facilement accès à un titre de séjour aux femmes étrangères victimes de violences.
- 6 avril 2016 : Vote de la Loi n° 2016-444 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées : création du parcours de sortie de la prostitution, abrogation du délit de racolage, interdiction de l’achat d’un acte sexuel.
- juin 2016 : Odile Renaud-Basso, 1ère femme Directrice générale du Trésor.
- 1er juin 2016 : Autorisation du don de sang par des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (sous condition de 12 mois d'abstinence, elle passe à 4 mois d'abstinence à partir du 2 avril 2020).
- 8 août 2016 : La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels introduit l’interdiction de tout agissement sexiste dans le règlement intérieur de l’entreprise. Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi.
- 7 octobre 2016 : La loi pour une République numérique crée un délit d’atteinte à la vie privée à caractère sexuel (revenge porn).
- 18 novembre 2016 : La loi de modernisation de la Justice au XXIe siècle est promulguée : création du divorce par consentement mutuel sans juge, par acte sous signature privée contresigné par avocats après dépôt auprès d’un notaire.
- 2017 : Maryline Gygax Généro, 1ère femme médecin général des armées, directrice centrale du Service de santé des armées.
- 27 janvier 2017 : Les femmes menacées de mariage forcé sont reconnues par la loi relative à l’égalité et la citoyenneté comme public prioritaire à l’accès à un logement social.
- 27 février 2017 : La loi portant réforme de la prescription en matière pénale prévoit un allongement des délais de prescription à 6 ans à partir du jour où l’acte a été commis en matière de délits comme les violences par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS, les agressions sexuelles autres que le viol, le harcèlement moral, les menaces de meurtre, de viol ou d’agression sexuelle.
Les délais de prescription en matière de crimes sont allongés à 20 ans pour les viols, violences d’un conjoint, concubin ou partenaire de PACS ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les meurtres, les enlèvements et séquestrations. - 20 mars 2017 : Promulgation de la loi du 20 mars 2017 qui étend le délit d’entrave à l’IVG aux nouvelles pratiques virtuelles. Elle punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne.
- Octobre 2017 : L’affaire Weinstein, du nom du producteur américain dénoncé pour harcèlement sexuel par plusieurs actrices, provoque dans de nombreux pays, dont la France, une libération de la parole. Après ces révélations, des milliers de femmes racontent sur Twitter, via les mots-clés #MeToo et #BalanceTonPorc, le harcèlement voire les agressions sexuelles dont elles ont été victimes.
- 2018 : Anne Rigail, 1ère femme directrice générale d'Air France ; Véronique Malbec, 1ère femme secrétaire générale du ministère de la Justice ; Sophie Adenot, 1ère femme pilote d'essai d'hélicoptères.
- 3 août 2018 : Promulgation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Elle comprend quatre points :
- l’étendue du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs à 30 ans à partir de la majorité de la victime ;
- le renforcement des dispositions du code pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur les mineurs ;
- la création d’une infraction d’outrage sexiste pour réprime le harcèlement dit "de rue" ;
- l’élargissement de la définition du harcèlement en ligne.
- 4-12 septembre 2018 : Carole Bureau-Bonnard, 1ère femme présidente de l'Assemblée nationale (par intérim).
- 2019 : Sylvie Bermann, 1ère femme élevée à la dignité d'ambassadrice de France.
- 2020 : Dominique Arbiol, 1ère femme directrice générale de l'École de l'Air ; Pascale Regnault-Dubois, 1ère femme directrice générale des CRS.
- 16 juillet 2020 : Claire Landais, 1ère femme secrétaire générale du gouvernement.



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire